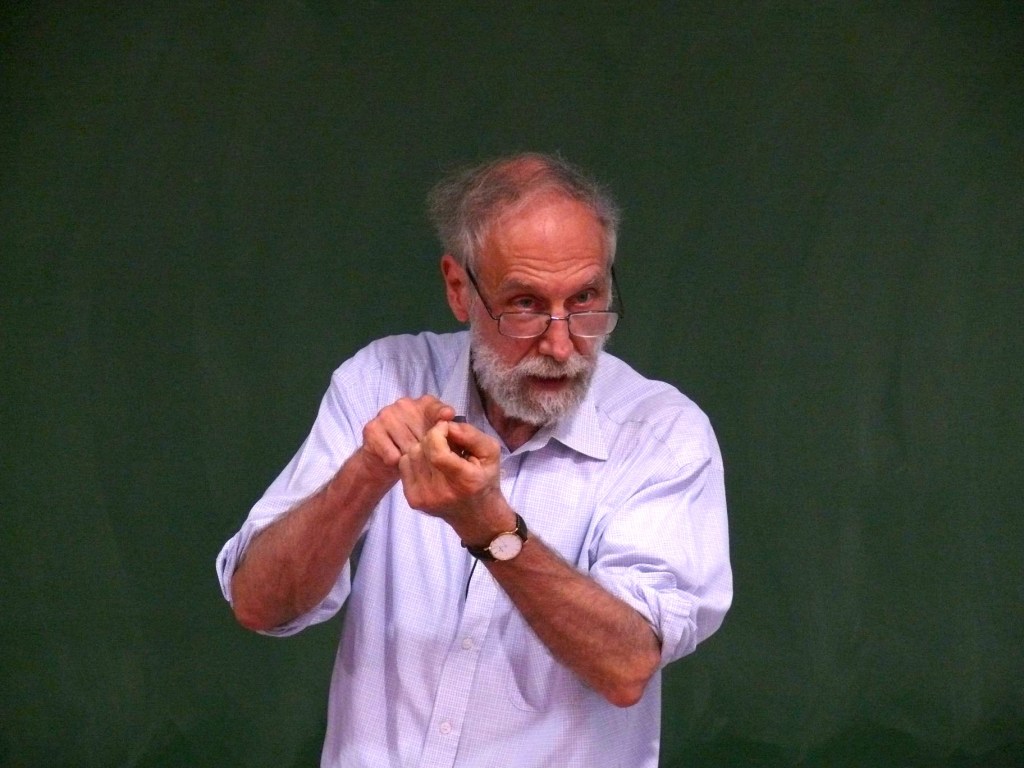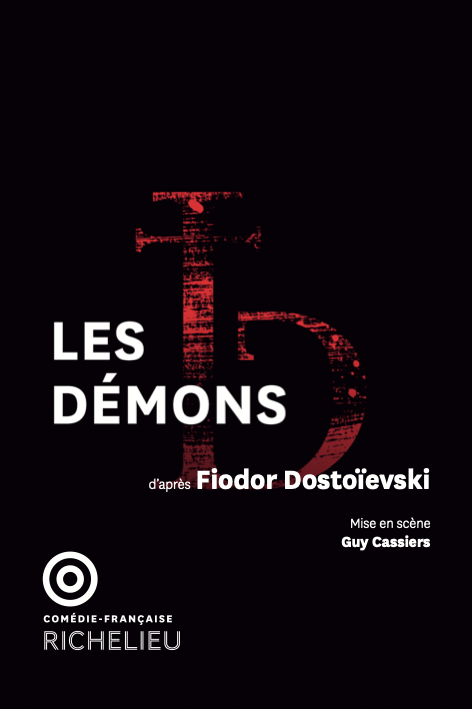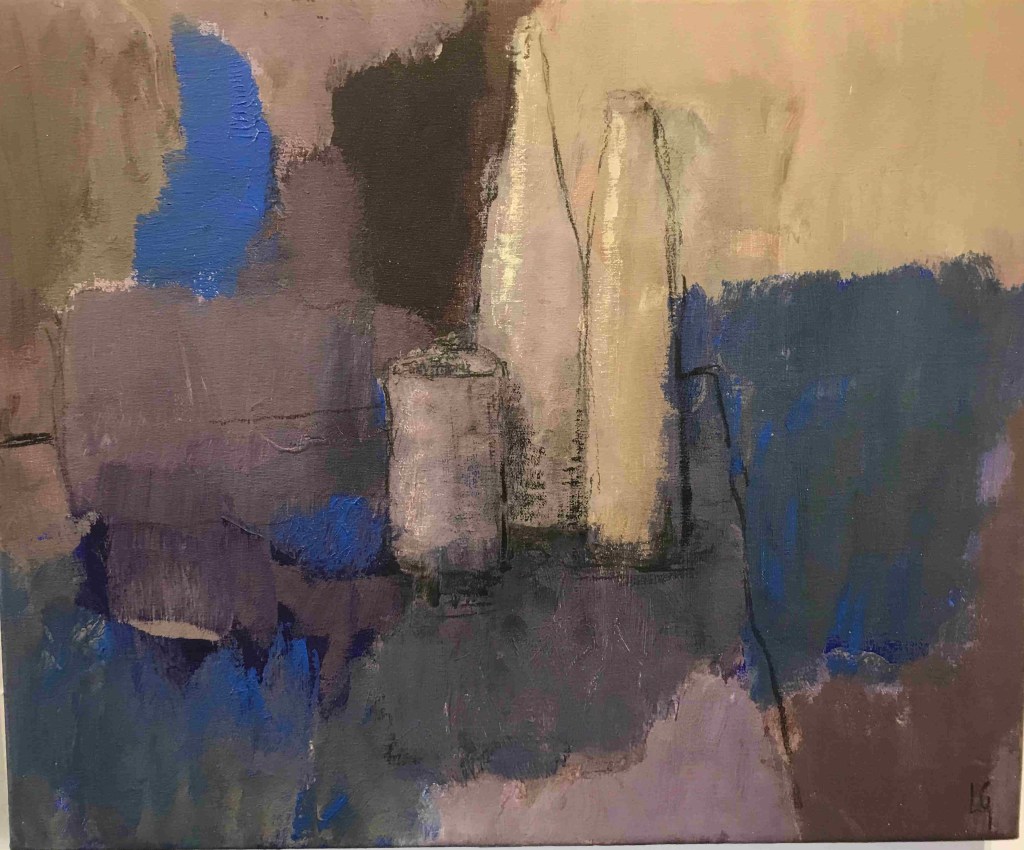Séjour à Saint-Malo où j’accompagne C. à une cure thermale et où je me prends à suivre les mêmes traitements. Première fois de ma vie où je déambule en peignoir au milieu des salons où convergent les offres de soin, de l’enrobage d’algues aux douches sous-marines, croisant des zombies similaires à moi-même, un verre de tisane à la main… Mais il y a la côte, les balades agréables au bord de l’océan jusqu’à la pointe de la Varde et jusqu’à Rothéneuf.

Dans de tels moments nous reviennent en mémoire des lectures qui s’y rapportent. Cette ambiance d’ennui auprès d’un bar où les curistes tentent d’oublier l’eau chaude, n’en avons-nous pas déjà lu la description dans La Montagne magique ? Sauf qu’ici, il n’est heureusement question ni de maladie grave comme la tuberculose, ni de mort, mais juste de stress à évacuer ou de corps à adoucir, de membres à réparer, de lombaires à soulager. Le public est du genre aisé, plutôt bourgeois, certes on y voit des retraités qui n’ont pas l’air bien riche mais ici comme à la crêperie centrale de Saint-Malo (près de la cathédrale) on entend parler taxe foncière, prix de l’immobilier et placements intéressants.
Que faire à Saint-Malo, hors festival Etonnants voyageurs ? Faire connaissance avec Chateaubriand, bien sûr, dont la prose embellit les moments d’attente entre deux « soins » (comme on dit ici). J’ai hésité à dire tout de suite que cette prose était sublime. Pourtant elle l’est, mais encore faudrait-il dire en quoi elle l’est, et montrer des exemples. Lire enfin Les Mémoires d’Outre-Tombe, quand on atteint un âge qui signifie les trois-quarts d’un siècle, quel événement. Proust, dit-on, y voyait un modèle pour La Recherche du Temps perdu avant qu’il ne l’écrive. Je comprends pourquoi. Je ne savais pas que ces mémoires commençaient à la naissance du petit François-René et couvraient son enfance et son adolescence. « Longtemps je me suis couché de bonne heure » écrivait Marcel en pensant à l’enfant unique qu’il était, devant s’endormir dans le noir à peine tempéré par une lanterne magique, « C’est sur la grève, du côté de la pleine mer entre ce château et un fort appelé le Fort Royal que se rassemblaient les enfants de la ville. C’est là que conduit par ma bonne ou par un domestique, j’ai été élevé comme le compagnon des vents et des flots » dit Chateaubriand. Bien sûr, ce n’est pas la même chose et l’on sent bien qu’il en résultera des trajectoires bien différentes, mais c’est ainsi qu’on donne le la d’une épopée en quoi une vie se résume. Une autre référence qui me saute aux yeux va vers cet autre génie du XIXème mais qui vient bien après, à savoir Stendhal, qui commençait ses mémoires sous le titre de « La vie de Henry Brulard » par ces mots : « Je me trouvais ce matin, 16 octobre 1832, à San Pietro in Montorio, sur le mont Janicule, à Rome […] dans trois mois j’aurai cinquante ans […] Le soir en rentrant assez ennuyé de la soirée de l’ambassadeur, je me suis dit : je devrais écrire ma vie, je saurai peut-être enfin, quand cela sera fini dans deux ou trois ans, ce que j’ai été, gai ou triste, homme d’esprit ou sot, homme de courage ou peureux, et enfin au total heureux ou malheureux ». Stendhal est à Grenoble, ville où je réside ordinairement, ce que Chateaubriand est à Saint-Malo. Celui-ci se pose les mêmes questions sur pourquoi écrire ses mémoires sans paraître trop arrogant, trop donneur de leçon et sûr en toute occasion d’avoir raison : « je me suis souvent dit : « je n’écrirai point les mémoires de ma vie ; je ne veux point imiter ces hommes qui conduits par la vanité et le plaisir qu’on trouve naturellement à parler de soi, révèlent au monde des secrets inutiles, des faiblesses qui ne sont pas les leurs et compromettent la paix des familles […] J’écris principalement pour rendre compte de moi à moi-même ».
Les mémorialistes écrivent souvent des chefs d’œuvre quand ils s’affrontent à eux mêmes avec la détermination de ne rien laisser passer qui puisse être taxé de complaisance. Chateaubriand n’était pas heureux. Il le dit. On devine même en lui le regret d’être né. En tout cas à maints tournants de sa vie il eût préféré qu’on en finisse. On en vient donc à le plaindre. Pas un moment ne subsiste en nous cette image que l’on nous a donnée de lui : celle d’un vieil aristocrate réactionnaire s’opposant en tout point à ceux qui, bien après lui, tels Stendhal ou Victor Hugo, ont tenu bien haut le flambeau de la Révolution. Mais ce contraste doit être atténué : dans Les Mémoires d’une vie, ne dit-il pas qu’il fut, certes, « Bourboniste par honneur, Royaliste par raison » mais aussi « républicain par goût » ?
Je dois avouer ici que je n’ai lu que le début, et même, pour être plus précis, ce qui n’est pas encore les Mémoires d’Outre-Tombe et s’appelle plus simplement les Mémoires de ma vie, commencé en 1809, autrement dit bien avant l’Outre-Tombe dont la rédaction débute en 1832. Je me suis laissé dire (par l’excellent préfacier, Jean-Claude Berchet) qu’il y avait une différence de ton entre les deux textes, même si les trois livres qui composent le premier sont repris presque tels quels dans le second. Les Mémoires de ma vie semblent écrits avec la spontanéité d’un homme jeune qui n’a pour but que de mieux se connaître lui-même. En ce sens, elles s’inscriraient bien dans la lignée de Montaigne, alors que la visée des secondes mémoires semble plus historique, plus politique, il n’est pas anodin qu’elles commencent d’ailleurs par toute une généalogie rébarbative qui n’a pour but que d’ancrer le noble de Combourg dans une lignée historique qui remonte au temps de Saint-Louis. C’est pour cela que je préfère les premières de ces mémoires, manifestant probablement en cela un goût de mon époque qui s’intéresse davantage à la constitution d’un sujet qu’à la manière dont une personne illustre peaufine sa statue. Mais je ne dédaignerai pas les livres suivants, curieux que je suis de connaître les voyages en Amérique et les ambassades d’un homme qui eut son heure de gloire politique entre 1815 et 1830.
Ainsi, qu’apprend-on dans ces trois premiers livres ? Que le jeune François-René naquit à Saint-Malo un jour de tempête : « j’étais presque mort quand je sortis du sein maternel, et le mugissement des vagues battues par une tempête de l’équinoxe empêchait d’entendre mes cris », qu’il faillit bien ne jamais vivre, confié qu’il avait été à sa naissance à une nourrice stérile de Plancoët qui l’avait heureusement refilé à une amie fraîchement accouchée qui put l’allaiter et ainsi le sauva, mais avec la promesse qu’il fût entièrement dédié à la Vierge Marie jusqu’à ses sept ans : « une pauvre femme, amie de ma nourrice, et nouvellement accouchée, me prit à son sein avec son nourrisson. Croyant que j’allais expirer, elle me voua à la patronne du hameau, Notre-Dame de Nazareth, et promit si j’en revenais, que je porterai le bleu et le blanc jusqu’à l’âge de sept ans en l’honneur de la Sainte-Vierge. Ma mère ratifia son vœu. Je fus sauvé. Si on m’eût laissé mourir on m’aurait rendu un grand service », écrit-il pour relater l’incident, où l’on voit déjà percer cette sorte de dégoût de vivre dont j’ai déjà parlé et qui semble l’avoir suivi tout au long de sa vie. Plus haut, d’ailleurs, à propos de sa naissance, ne dit-il pas que sa mère [lui] fit le funeste présent de la vie ? On apprend aussi quel garnement il était autour de l’âge de sept ou huit ans quand il jouait à la bagarre en compagnie d’une âme damnée du nom de Géril. Quand on longe la digue du Sillon (par laquelle l’île de Saint-Malo se trouve raccordée au continent), on est toujours surpris par ces troncs d’arbre usés et blanchis par les assauts de l’océan qui sont plantés droits sur la plage, soit dans un sens parallèle à la digue soit perpendiculairement, ressemblant à des sculptures de vieillards décharnés tendant leurs bras vers le ciel, ils sont destinés à briser l’ardeur des flots et à protéger la digue. Ils existaient déjà au XVIIIème. Les enfants de Saint-Malo s’y amusaient, en tout cas ceux et celles qui avaient bonne et domestique et voulaient les faire enrager. « Un de nos grands plaisirs était de monter en haut de ces pieux, de nous y asseoir et de voir passer en dessous-de nous les premiers flots de la mer montante », mais hélas un jour, ce gredin de Géril pousse l’enfant juste à côté de lui au moment de l’arrivée d’une grosse lame, les enfants se tombent les uns sur les autres mais personne n’est jeté à la mer, jusqu’à ce que l’onde de choc se propage vers notre jeune héros qui tombe sur une petite fille qui se trouve en bout de file, laquelle tombe à la mer et manque de se noyer. Emois dans Saint-Malo, la petite fille accuse François-René qui n’y pouvait pas grand-chose, il se cache dans les caves, est assailli par les bonnes, Géril le délivre en lançant des patates sur les assaillantes… Ce sont les passages les plus drôles de ces mémoires, bien entendu, car pour le reste, hélas, dès que François-René devient adolescent, il se départit rarement d’une tristesse permanente et qui l’assaille surtout du fait de ces longues journées et nuits passées au château de Combourg (le train y passe aujourd’hui entre Rennes et la cité malouine) où il séjourne en compagnie de sa sœur aimée Lucile, de sa mère et d’un père particulièrement lugubre qui fait les cent pas, le soir, dans la pièce où rougeoie l’âtre avant d’aller se coucher et de laisser enfin un peu de soulagement au reste de la famille… Le jeune Chateaubriand vit dans un monde où le plaisir n’est pas de mise et où les désirs sont fortement réprimés. Des pages dépeignent alors ce processus de sublimation plus tard évoqué par Freud et qui a fourni sans doute les plus grandes envolées du romantisme. « Je me composai donc une femme de toutes les femmes que j’avais vues : elle avait la taille, les cheveux et le sourire de l’étrangère qui m’avait pressé contre son sein ; je lui donnai les yeux de telle jeune fille du village, la fraîcheur de telle autre » car bien sûr entre temps, il y avait eu ce moment délicieux d’une première fois où, par accident, il s’était vu projeté contre la poitrine d’une belle…
Je n’en dirai pas plus. La prose de Chateaubriand est sublime parce qu’elle est faite de phrases rapides, qui vont droit à leur cible qui est de toujours transmettre une émotion : pas d’explications inutiles, ni de paraphrases pédagogiques, la langue est utilisée pour faire revivre les souvenirs, elle est l’auxiliaire zélé de la mémoire.

A propos de l’aspect mémoriel, il est intéressant de revenir à la préface écrite par Jean-Claude Berchet quand, évoquant le « labyrinthe de la mémoire », il essaie de décrire les rapports du narrateur au temps. Dans les Mémoires d’Outre-Tombe, plus que dans Les mémoires de ma vie, s’entremêlent en effet des temporalités différentes, il y a notamment celle du narrateur présent qui parle depuis une époque qui connaît les bouleversements de l’histoire (révolution, empire, restauration…) et se doit de leur faire écho, en même temps que celle du personnage qui est certes lui-même, mais à distance, ce qui peut le conduire à évoquer une époque sereine depuis une période sombre ou bien l’inverse. « Le discours sur soi implique assez vite un discours sur « soi dans le temps » ». Comment s’arracher au temps ? Chateaubriand se rend vite compte que c’est impossible. En recherchant ce qu’on a été, on ne trouve pas une image fixe, il n’y a pas de personnage immuable qui nous attendrait au coin de la mémoire : il est toujours déjà transformé. « Loin de rendre au moi sa substantialité réconfortante, la mémoire en dénonce le leurre », ainsi, plus on écrit, plus le moi se dissout en mirages : « le passé manque, ou il dévore le présent » dit Berchet. « La mémoire est incapable de nous restituer une présence immédiate à la plénitude de nous-mêmes : « Lorsque je fouille dans mes pensées, il y a des noms, et jusqu’à des personnages qui échappent à ma mémoire, et cependant ils avaient peut-être fait palpiter mon cœur : vanité de l’homme oubliant et oublié » (XIII, 2). Ainsi ces Mémoires (et là peut-être est toujours l’intérêt de ce genre littéraire) nous plongent-elles au cœur d’une méditation profonde sur le temps et sur notre être-dans-le temps : « toute chose change, le moi lui-même change ; mais c’est toujours MOI qui change, qui a conscience du changement. La seule victoire envisageable sur le temps consiste donc à épouser son mouvement, à se faire conscience du temps, à se déprendre du réel » dit encore le préfacier. Mais ce n’est peut-être pas encore aussi simple qu’il le dit. Il est rassurant de penser que dans ce changement perpétuel, il y a au moins quelque chose de stable : ce MOI qui change. N’est-ce pas une pirouette ? Un artifice facile, un jeu sur les mots et la grammaire. Oui, tout texte présuppose un « je » mais ce « je » ne se définit-il pas que comme artifice de langage, nécessité de la grammaire ?
On sent ici la nécessité d’aller plus loin dans la connaissance du temps… en quoi je tente de rejoindre les réflexions d’il y a quelques semaines, sur le temps vu d’un point de vue mathématique, au travers notamment de la géométrie non commutative… mais ceci est une autre histoire. J’y reviendrai. Comme quoi réfléchir à un auteur comme Chateaubriand n’est pas si vain, puisque, dans son interrogation sur le temps, il demeure bien… intemporel.