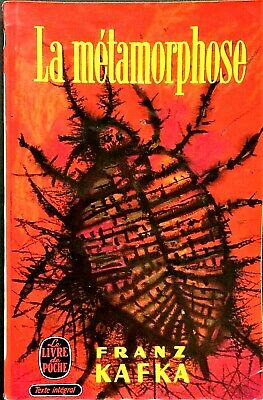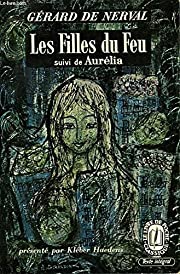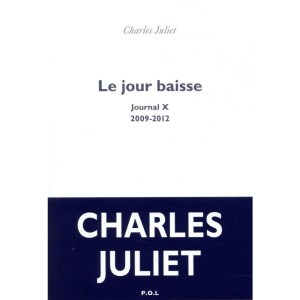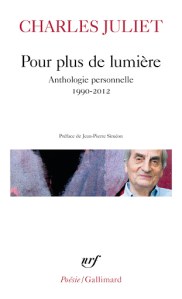La question du genre bouscule nos habitudes. Récemment, j’entendais à la radio l’ethnologue Martine Segalen (auteure de « Avoir vingt ans en 2020 ») faire part de son étonnement, après avoir envoyé un questionnaire à des jeunes, de recevoir de nombreuses protestations outrées au sujet de la rubrique « sexe » qu’elle avait demandé de renseigner de façon routinière. Elle n’avait pas vu le changement qui s’était produit dans les toutes dernières années. Elle aurait demandé « genre » à la rigueur… et même là, les destinataires lui auraient demandé ce que ça pouvait bien lui faire. Car le genre se choisit, alors que le sexe n’est rien. Du moins c’est ce qu’ils pensent. Moi, qui suis d’un autre temps, je suis un peu effrayé face à ce qui me semble être la plus grande entreprise de déni que l’on ait tenté depuis les débuts de l’humanité. Mais peut-être me trompé-je.
Je pense que l’on aime se débarrasser de ce qui nous gène. Et le sexe nous gène. Il s’impose à nous, il est tyrannique. On le voit sans cesse, il fait la une des journaux et les gros titres de l’actualité. Il n’est pas reluisant sous ces formes-là. Quand on est un homme (ce que je suis et que j’assume) on a honte de son sexe, car à n’en pas douter, ce sont les hommes qui violent, qui asservissent, qui contraignent mineurs et femmes à en passer par leur « irrésistible désir », du moins c’est ce qu’ils disent : que leur désir est irrésistible alors qu’il est le plus souvent mêlé à autre chose, leur volonté de pouvoir (ou de puissance, si l’on est plus nietszchéen).
Peut-on aujourd’hui écrire un billet qui s’intitulerait « Être homme », similaire à ce que j’ai lu sous la plume d’une jeune blogueuse que j’admire beaucoup, qui a écrit son article « Être femme » ? C’est la question que je me suis posée en la lisant, et que je lui ai posée. « Etre un homme », cela vous a des allures moralisatrices de texte à la Kipling mais c’est principalement à cause de l’ambiguïté du mot : il sert aussi à désigner l’humain dans son ensemble. Philip Roth, qui s’y est essayé sous la forme d’un roman autobiographique, a proposé le titre « Everyman », traduit incorrectement en Français par « Un homme ». L’expression française n’évite pas l’ambiguïté signalée plus haut, alors que le titre américain est moins substantialiste, il fait appel à ce qu’un logicien (que je suis) nomme un quantificateur, autrement dit une expression linguistique n’ayant pas de contenu substantiel par elle-même (noter qu’en logique, « everyman » se représenterait par une abstraction sur toutes les propriétés qui pourraient découler du fait que l’on soit un homme… c’est bien exactement ce que nous voulons!).
Il est risqué de se lancer dans l’écriture d’un tel billet, surtout lorsqu’on est déjà âgé, déjà un vieil homme. Inévitablement, on sera accusé de remettre au devant de la scène des notions anciennes, peut-être dépassées, de s’exposer en tant que vieux sage qui sait, lui, alors que les plus jeunes ne savent pas. Et pourtant, je ne juge pas cela dénué de tout intérêt. On l’a compris depuis longtemps : ce blog n’est pas fait pour donner des leçons, ni même pour être lu (!), mais juste pour moi, pour approfondir et clarifier ma pensée. S’il est lu, tant mieux, cela pourra permettre de faire naître un dialogue, mais il me faut avertir encore le lecteur : un blog est, par définition, un lieu public et on ne dévoile pas en public le fond de son intimité, que l’on ne s’attende donc pas à ce que je me dévoile, ou que je livre quelques détails trop intimes. Il faut tenter de dire une certaine vérité sur soi tout en restant dans la pudeur et le respect. Je note que Charles Juliet qui, pour moi, est une sorte de modèle en ce qui concerne la connaissance de soi ne dit presque rien sur sa sexualité, cela peut paraître contradictoire avec l’objectif poursuivi, et pourtant, on arrive à comprendre qu’il y ait une voie possible entre le discours théorique et l’étalage de coucheries (si coucheries il y a…).
Qu’est-ce que se sentir homme ? Qu’est-ce que cela fait d’être un homme ? Bien sûr, cela commence très tôt par l’attrait pour l’autre sexe, la curiosité qui se mue en désir. Enfant, parmi toutes les attractions de cirque, ma préférée était les numéros de trapéziste car on y voyait de jolies jeunes femmes très légèrement vêtues… ou bien, lorsque j’allais à la mer, je lorgnais les belles baigneuses. Même à dix ans et peut-être avant. J’avais commencé ma scolarité dans des écoles de garçons. J’ai souvent raconté ma joie de débarquer en quatrième dans un lycée mixte, sentiment d’avoir accès enfin à l’autre moitié du monde, des êtres plutôt fins et jolis, ayant un rire frais et des voix enchanteresses en cours de musique au lieu de balourds ricanants aux traits taillés à la serpe et à la voix qui déraille. On est très vite amoureux, on ne pense plus qu’à l’une d’entre elles, on croit avoir son nom écrit dans les lignes de sa main, mais quand on a la possibilité de cueillir un baiser de sa part, on disparaît, on flanche, il n’y a plus personne. Le sexe apparaît à ce moment-là, sous la forme d’un démon en soi dont on ne sait que faire.
Je n’ai jamais supporté que l’on dise du mal des femmes, peut-être le dois-je à mon éducation : aussi loin que je me souvienne je n’ai jamais entendu de propos méprisants à leur égard que ce soit venant de mon père ou de mes grands-pères. Il n’y eut qu’un cousin de mon père qui proférait parfois des paroles grivoises, mais je n’ai pas le souvenir que ce fût méchant, juste parce qu’il fallait bien rire un peu. Récemment, un ami drômois me prêta un livre qui avait été écrit par un de ses amis et publié à compte d’auteur, il voulait savoir si ce livre était intéressant et s’il justifiait que l’ami fût invité à l’une de nos réunions littéraires. Le livre était organisé en rubriques. A l’une d’elles, il était question de premier amour. Je lus avidement. Cet homme racontait effectivement son premier amour avec une petite paysanne du village où il habitait, mais il terminait par un éclat de rire : un de ses copains lui avait dit plus tard que « machine était une pute ». Je refermai ce livre avec dégoût. Voilà qui est répugnant chez un homme, traiter l’autre sexe avec mépris, ne pas respecter ses premiers émois, ne pas marquer la moindre fidélité à celle pour qui notre cœur a battu une fois. Et puis, ce mot, que veut-il dire ? Je n’en sais rien. Il m’est arrivé dans ma prime jeunesse de vivre des amours déçus, des échecs amoureux et de tristes débandades, il m’est arrivé d’en vouloir à certaines car j’avais le sentiment d’avoir été humilié par elles, mais ce mot…
Racontant cela sans vouloir faire le héros, le pur ou le meilleur que les autres, je me rends compte à quel point la masculinité a à voir avec l’orgueil, la fierté voire un assez stupide sentiment d’honneur.
Beaucoup d’hommes font comme si « la femme » était un problème, et qu’il faille en faire le tour une bonne fois, pour s’en débarrasser, afin que la question soit réglée et que l’on passe enfin à autre chose. Du moins c’est ce que j’ai cru comprendre en conversant avec certains d’entre eux. Ce collègue qui m’avait dit un jour avoir tout soldé en allant « voir une pute » (nous y voilà encore à ce mot…), cet autre qui conseille à son fils souffrant d’un chagrin de liquider une bonne fois le problème et de faire comme lui : aller voir les putes (encore!) quand il a « besoin d’une femme ». Ce sont là des recettes d’autrefois, colportées de père en fils dans le secret des familles. N’existait-il pas alors dans les grandes familles bourgeoises la tradition « d’offrir une fille » à son garçon pour ses dix-huit ans ? On ne saurait mieux exemplifier la construction sociale de la masculinité.
Réfléchissant beaucoup à la question d’être homme, il me vient inévitablement à la pensée le souvenir d’une amie dont j’avais été très amoureux à l’âge du lycée et avec qui l’affaire ne s’était pas très bien passée – manque d’expérience, peur, gaucherie… on n’est pas un latin lover au premier essai… Je la revis plus tard et nous sommes restés amis (qu’elle me pardonne si elle me lit) et nous reparlâmes rarement de nos rendez-vous manqués, sauf une ou deux fois dont une où elle m’écrivit sur une carte postale qu’il était dommage que nous n’ayons pas été du même sexe. Cela me lassa pantois et même en colère. Je ne répondis pas et j’interrompis les échanges pendant quelques temps. C’est lorsqu’on vous dit des choses pareilles que vous êtes amené à vous poser le genre de question qui nous occupe ici, question de son propre rapport à son sexe ou à son genre. Elle voulait évidemment dire qu’elle m’eût préféré en ami plutôt qu’en amant. Mais outre que je ne crois guère, contrairement aux conseils donnés par le doux Montaigne, que l’amitié soit supérieur à l’amour (voire fondamentalement distincte… l’amitié n’est-elle pas une forme d’amour sublimée?), cette affirmation abrupte me faisait me demander dans un vertige si c’était elle qui se fût préférée en homme ou bien moi qu’elle eût préféré femme ? Les deux cas étaient gênants, mais à supposer que ce soit le deuxième qui prévale, cela me conduisait à un profond désarroi : comment aurais-je pu être femme ? Y a-t-il forme de négation pire que celle où l’on vous dénie d’être du sexe qui est le votre ? Je ne me sentais pas attaché à ma virilité et pourtant il me fallait bien admettre que l’être-homme en moi était constitutif de ma personne et que mon amie aurait voulu me le retirer.
Mais tous les exemples ici donnés, les mots, les échecs, les sentiments évoqués, tout cela ne renvoie-t-il pas au fond à un seul sentiment : la peur ? La réaction de l’homme qui croit résoudre ses problèmes en se réfugiant vers certaines femmes « qui seraient faites pour ça » (??), celle de celui qui réagit fortement à la seule idée qu’on lui retire son sexe, l’usage de mots méprisants, cassants, tout cela ne traduit-il pas avant tout la peur ? Peur de l’autre bien entendu, peur de qui est vu si différemment que nous ne sommes, peur de qui peut avoir un tel ascendant sur nous en nous faisant « tomber amoureux », peur surtout de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir rendre ce que l’on nous donne ? La peur est là si tôt… je l’ai déjà évoquée à propos des premiers émois amoureux et légèrement plus tard, quand on doit passer à l’acte sexuel, peur que le sexe ne bande pas, ou pas assez, ou mal, peur « qu’on n’y arrive pas » et sentiment terrible que plus on pense à cette peur-là plus elle se trouve justifiée, car en effet elle finit par nous inhiber. Rien n’est plus triste dans certains films que ces histoires de héros qui ont glorifié en imagination la femme dont ils ont été séparés et qui, le jour des retrouvailles enfin arrivé, perdent leurs moyens. Je me souviens d’un bel exemple d’un tel film avec Maria’s Lovers, d’Andreï Kontchalovsky datant de 1984 avec Nastassja Kinski et John Savage. Ce film, quand je le vis, me fit beaucoup de bien car… il se termine bien !
L’amour enfin rencontré dissout cette peur (c’est la leçon optimiste à tirer de Maria’s Lovers), mais elle persiste toujours plus ou moins, elle revient à l’occasion d’un accident de la vie et elle revient dans la vieillesse. Les derniers romans de Philip Roth l’ont suffisamment montré : tout tourne presque toujours autour de la prostate du héros… Le cancer de la prostate chez les hommes est le pendant sans doute du cancer du sein chez la femme, avec ceci de particulier que dans de nombreux cas, un nerf fondamental se trouve sectionné lors de l’ablation, qui est celui qui commande l’érection. Je me souviens à ce sujet de La balance des blancs, le livre de Jacques Henric… tout entier écrit alors que l’auteur subissait annonce du diagnostic, attente et opération. Là encore, cela se termine bien. Mais l’angoisse de la perte est là, béante. Henric croit y voir la source de nombreuses œuvres, ainsi de Suzanne et les vieillards, tableau auquel il consacre des pages éblouissantes.
Mais d’où vient cette peur ? Il est commun de dire, notamment dans les discours féministes, qu’elle n’est qu’une peur de perdre le pouvoir, la faculté en somme d’asservir les femmes à son propre désir, à sa propre volonté, comme si, à ne pas avoir ce petit organe, nous, hommes, nous retrouverions nus, sans pouvoir et sans prestige. En somme, notre sexe bandé serait une arme, un gourdin que nous assénons à celles sur lesquelles se serait jeté notre dévolu. Vieille gravure d’une préhistoire naïve montrant des êtres sauvages mi-humains mi-bêtes qui n’auraient obéi évidemment qu’à leur instinct et auraient ignoré l’amour – une invention moderne ! – alors que toutes les visites que nous pouvons faire à la Grotte Chauvet nous enseignent que nos lointains ancêtres étaient bien peu différents de nous. On l’a compris, je n’y crois guère. Cette peur est celle de perdre non pas ce qui nous permet de dominer l’autre, mais ce qui nous permet de l’atteindre. De l’atteindre enfin. Jacques Lacan avait introduit la notion de point de capiton pour décrire la façon dont l’inconscient rejoignait le réel, cette même notion peut à mon avis servir pour désigner la façon dont « je » fusionne avec « tu ». Ces points de capiton sont alors les moments où l’on fait l’amour. Ils nous font éprouver l’expérience de sortir hors de soi, d’annihiler un bref instant la distance qui nous sépare de l’autre, dans ce feu d’artifice dont on ne retrouvera jamais l’intensité dans d’autres types d’expériences. Cet amour, ressenti physiquement, est ce qui donne sens à notre vie, bien plus que ne le feraient le pouvoir, l’argent et même la religion.
A l’âge de la vieillesse, on perd certes un peu de cette faculté magique à se transcender dans l’amour sexuel, d’où nos craintes, à nouveau nos peurs. J’ai honte de dire que je suis bien heureux de vivre à une époque et dans des lieux où la science a suffisamment avancé pour permettre à la chimie de suppléer quelques manques et continuer malgré les années à aimer de toutes ses forces. Ici, il faut donner la parole à Vladimir Jankélévitch dans Le Paradoxe de la morale (p. 63) : « S’arrêter ? Mais il ne faut jamais s’arrêter ! Même pour souffler, même pour survivre… Cesser d’aimer est un crime ». Ce qu’il complète par la maxime de saint Augustin selon laquelle la seule mesure de l’amour est d’aimer sans mesure.
Qu’il y ait des hommes pour ne pas se plier à cette maxime, voilà qui est bien dommage, on ne s’étonnera pas, après, qu’il y ait tant d’hommes malheureux. Qu’il y ait des hommes pour non seulement ignorer cette maxime mais en plus la bafouer au nom d’une perversion de l’amour qui n’en donnerait que d’odieux simulacres emprunts de violence, voilà qui non seulement est dommage mais qui fait honte au genre humain.