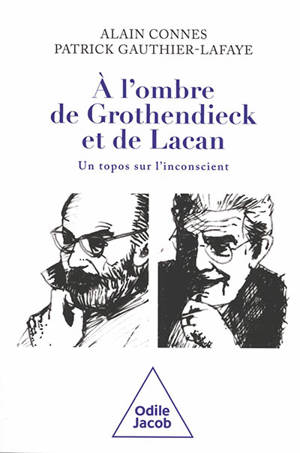Il aura fallu sans doute que je me trouve face aux Annapurnas pour que j’en vienne à me passionner pour l’histoire de leur conquête. Je n’y avais guère prêté d’intérêt auparavant. C’est lorsqu’on a face à soi ces énormes murailles de neige et de glace qu’apparaît de manière urgente le besoin d’en savoir plus sur la façon dont des humains peuvent les affronter. Puisque nous sommes trop vieux pour penser un seul instant les attaquer nous-mêmes, nous plongeons dans les livres de ces géants qui ont été les premiers à oser en faire l’ascension. Le plus connu de tous est celui écrit par Maurice Herzog : Annapurna, premier huit mille, qu’on lit comme un passionnant roman. Pas la peine ici d’inventer une intrigue, elle est là, sous nos yeux. L’intrigue, c’est la montagne et ses difficultés immenses. L’une des particularités de l’expédition de 1950 à l’issue de laquelle Herzog et Lachenal parvinrent au sommet de ce que l’on nomme aujourd’hui l’Annapurna I (puisque d’autres sommets ont acquis ce nom, allant jusqu’à IV avec en plus l’Annapurna Sud qui est le premier à s’être dévoilé à nos yeux) est que, contrairement à d’autres expéditions qui avaient tenté de gravir de hauts sommets auparavant (le Nanga Parbat, l’Everest ou le Dhaulaghiri), c’est la même équipe qui explore les voies d’accès, trouve un chemin praticable, et finalement « passe à l’assaut » (tant le vocabulaire guerrier était encore à la mode en ces années d’immédiat après-guerre). L’équipe autour d’Herzog comprenait des alpinistes professionnels déjà chevronnés : Louis Lachenal bien sûr, mais aussi Lionel Terray, Gaston Rebuffat, Jean Couzy et Marcel Schatz, accompagnés d’un officier de liaison à la fois alpiniste et diplomate : de Noyelle, d’un cinéaste, Marcel Ichac, d’un médecin le docteur Jacques Oudot, et de nombreux sherpas : Ang Tharkey, Foutharkey, Panzi, Sarki … Ils se divisèrent souvent en sous-groupes chacun étant chargé d’explorer un nouveau recoin de ces montagnes encore si peu connues. C’est ainsi, au début, qu’ils tentèrent d’explorer les abords du Dhaulaghiri, pour parvenir à la conclusion que ce sommet était trop difficile : ils pensèrent même que jamais personne ne l’escaladerait (or il le fut en 1960 par une équipe suisse dirigée par Max Eiselin, qui comprenait entre autre un certain Michel Vaucher que C. connaît bien parce qu’il résidait dans cette petite vallée du Valais où elle allait souvent – et va encore souvent). Ensuite, basés qu’ils étaient à « Tukucha » qu’on trouve aujourd’hui sur la carte sous le nom de Tukutche, ils partirent vers l’Annapurna. Se fiant à des cartes de l’armée qui s’avérèrent fausses, ils partirent le long de la Mistiri Khola (affluent de la Kali Gandaki) vers l’est afin de franchir un col d’où, pensaient-ils, ils découvriraient la montagne qu’ils ciblaient. Mais en réalité après le col, il n’y avait pas cette montagne, mais un lac, et au-delà de ce lac une véritable barrière rocheuse qu’il fallait encore gravir pour être à pied d’œuvre. Ce lac est aujourd’hui connu et répertorié : sur les cartes il porte le nom de Tilicho, encadré par deux cols donc : un Tilicho ouest et un Tilicho est. Si j’étais plus jeune, mon rêve serait d’aller voir ce lac, mais même s’il existe en effet un trek qui y conduit, je pense que je serais incapable de me livrer à une telle marche. De cet endroit, Herzog et ses amis jugèrent qu’il existait un passage possible vers le sommet de l’Annapurna, qui consistait à escalader directement des murs de glace, et même une cascade de glace, afin de se retrouver sur une sorte de glacier en corniche qu’ils avaient baptisé « la faucille » et de marcher sur une pente enneigée jusqu’au sommet, à 8090 mètres. Plus facile à dire qu’à faire… Ayant fait cette reconnaissance, ils allèrent plus à l’est vers la « ville » qu’ils appellent Manangbhot, aujourd’hui sur les cartes simplement Manang, où ils pourraient trouver du ravitaillement. Si c’était pour eux une suite de découvertes incessantes (car visiblement ils ne s’étaient guère documenté auparavant sur les caractéristiques ethniques des peuples vivant en ces lieux, travers habituel des alpinistes plus intéressés par les rochers et les pierres – et leurs performances ! – que par les populations qui vivent au fond des vallées), il en était de même pour ceux qu’ils visitaient et qui, très probablement, voyaient pour la première fois des occidentaux. Les descriptions nous étonnent, les alpinistes français semblant être tombés dans un autre monde, à peine humain, peuplé parfois des personnages attrayants comme ces femmes tibétaines aux tabliers bariolés qui dansent, un matin, sur la place du caravansérail, d’autres fois terrifiants comme ces villageois dont le visage est recouvert de boue (ils me font penser aux habitants de Lingshed, quand nous étions allés les voir en 2011, nous avions trouvé aussi une population vivant dans beaucoup de crasse, manque de savon tout simplement), à Manang ils se heurtent à une foule d’hommes vociférants qui leur proposent des femmes contre des roupies, « sont-ce des sauvages ? A quelle sauce veulent-ils me manger ? ».






photos extraites du livre « Regards vers l’Annapurna » de Maurice Herzog et Marcel Ichac (1951), avec de haut en bas et de gauche à droite: le camp II, les sherpas Foutharkey et Adjiba, Ang-Tharkey, la « maison au balcon vert » à Tukuche, les gorges de la Kali-Gandaki et Maurice Herzog au sommet
Une fois rapprochés de l’Annapurna, ils installent leur camp au bas du glacier est. Il faudra ensuite qu’ils installent les autres camps, I, II, III, IV et V. Ici les sherpas font le travail de l’ombre, ils trimballent les tentes, les accessoires et le ravitaillement d’un camp à l’autre. Certains des alpinistes français aussi d’ailleurs, car ils doivent se diviser les tâches. C’est un peu par hasard que, le dernier jour, ce soit Herzog et Lachenal qui se trouvent au camp V qu’ils viennent d’installer, prêts à bondir pour le dernier tronçon qui va les emmener à plus de 8000 mètres. Ils sont allés le plus vite possible puisqu’ils sont déjà menacés par l’arrivée de la mousson, qui doit avoir lieu le 5 juin (c’est le 3 juin qu’ils parvinrent au sommet). Herzog et Lachenal montent du camp II au camp III, ils voient redescendre les autres, dont Terray et Rebuffat qui leur disent la difficulté extrême : « Plus de sept heures pour aller du camp III au camp IV, hier, avec ce vent et cette satanée neige, déjà le froid s’est fait sentir : – Gaston sentait ses pieds qui se gelaient. – J’ai cru que ça y était me confirme Gaston, heureusement que Lionel m’a frotté et flagellé avec un bout de corde. Finalement, la circulation s’est rétablie ». Cela aurait pu servir d’avertissement, Terray et Rebuffat battent donc en retraite, pendant que Maurice et Louis continuent. Ils déménagent le camp IV (le mettent en haut de la fameuse « Faucille »), l’installation est plus dure que prévu : il faut creuser dans la glace. Ils sont encore accompagnés par deux sherpas, Sarki et Ang-Tharkey, Herzog, plein de générosité (ou plutôt de condescendance?) leur propose de rester avec eux jusqu’au sommet, afin de « partager la victoire ». Les deux, pas fous, déclinent l’offre : Ang Tharkey dit avoir déjà les pieds qui gèlent. Le jour ultime, ils ont passé la nuit au camp V et ils s’élancent au petit matin. Le froid les dévore. Lachenal est inquiet : il sent ses pieds qui gèlent, Herzog aussi probablement mais l’exaltation est telle qu’il semble peu y faire attention, se disant qu’en bougeant les orteils cela devrait suffire à éviter les gelures. C’est à ce moment que vient la scène centrale du roman, si j’ose dire (bien que ce ne soit pas un roman…), le point fatal, ce que peut-être un vrai romancier aurait eu du mal à inventer, l’endroit où se forme un court-circuit entre l’aventure individuelle et la réalité sociale. Ici, les défenseurs du « tout est politique » triomphent. Herzog est un ingénieur, un amateur en matière de montagne, il est là par « idéal » plus ou moins romantique, d’autres diront par ambition et recherche de gloire, alors que Lachenal vit de la montagne : il est guide professionnel à Chamonix. Le bourgeois et le prolétaire en quelque sorte. Lachenal tient à ses pieds qui sont ses outils de travail, Herzog y tient sans doute aussi, mais moins, qu’est-ce que la perte d’une paire de pieds face à la gloire inouïe que l’on peut attendre d’être le premier à avoir gravi un 8000 ? Nœud de l’intrigue, donc : Lachenal demande : « que ferais-tu si je décidais de redescendre ? » et Herzog, sans hésiter : « je continuerais seul », rendant alors impossible, de fait, la redescente de Lachenal, ce qu’il sait très bien : son compagnon ne pourrait en aucun cas le laisser seul dans des conditions aussi difficiles. Loin de se dépêcher, en plus, Herzog prend son temps au sommet : photos, drapeau français, fanions, il pense avant tout à l’accueil quand ils auront terminé. Et puis, cerise sur le gâteau, en rangeant son sac… il perd ses gants ! Incroyable bévue, qui ne saurait arriver à un professionnel… Pieds déjà gelés, mains qui vont l’être inévitablement, cela scelle un retour qui sera catastrophique. Et la deuxième partie du livre raconte cette redescente épuisante, ce véritable calvaire, les deux corps qu’il faut transporter sur des civières, les soins pratiqués par le docteur Oudot, terriblement douloureux : on croyait en ce temps-là qu’en injectant de la novocaïne ou de l’acétylcholine dans les artères, on dilatait les vaisseaux et retardait ainsi la progression des gelures, c’était atrocement douloureux et avéré depuis inutile. De nos jours, un hélicoptère les aurait attendus au camp de base, ils se seraient retrouvés à Kathmandu en moins de deux, à cette époque de tels moyens n’existent pas, il faut tout redescendre à pied dans la jungle népalaise, avec les coolies qui désertent car ils en ont assez (la chose a assez duré), ce qui entraîne la réquisition de force des villageois (!!) pour que l’expédition puisse se poursuivre et se terminer, avec les blessures qui s’infectent, le docteur Oudot qui coupe à chaque étape une nouvelle phalange, un pouce, un orteil, dans la puanteur et le pus qui gicle. Plus bas dans la vallée, Lachenal et les autres pourront prendre le train pour rejoindre Delhi, alors que monsieur Herzog voudra continuer à faire le beau, se faire recevoir par le roi du Népal, et pas question de rentrer avant lui à Paris : il est le chef de l’expédition et devra débarquer en premier. C’est décidément une aventure incroyable, avec son lot de cynisme, de naïveté, d’inconscience et… d’héroïsme (mais l’héroïsme, n’est-ce pas toujours un peu de tout cela à la fois?). Qu’adviendra-t-il ensuite ? On le sait pour Herzog : ministre de De Gaulle, homme adulé, rencontrant de multiples personnages célèbres, de J. F. Kennedy à André Malraux, et pour Lachenal, beaucoup moins de gloire (il mourra dans un accident de montagne, dans la vallée Blanche en 1955) mais un livre quand même. Comme la priorité éditrice avait été promise à Herzog, les autres ayant signé un contrat de non publication avant un délai de cinq ans, le livre de Lachenal ne pouvait paraître qu’après 1955, c’est-à-dire… après sa mort. Ce qui fit que le livre fut relu par les autorités de l’alpinisme (un certain Lucien Devies, président du Comité pour l’Himalaya, en qui Herzog voit une « personnalité gaullienne » ) avant publication, et expurgé. Ce n’est que parce que Lachenal avait un fils qui avait gardé une version du manuscrit que le « vrai » livre put être publié plus tard (« Les carnets du vertige »), apportant quelques rectifications à la légende dorée écrite par Herzog. Il est devenu très difficile de se le procurer aujourd’hui, un écrivain alpiniste américain, David Roberts, en donne des aperçus dans « Annapurna, une affaire de cordée », paru en 2000. Lachenal écrit, concernant leur retour dans la jungle népalaise : « L’inconfort était devenu intolérable. La fatigue, physique et morale, régnait sur les sahibs. C’est ce qui explique que l’attitude de mes camarades ait pu souvent justifier mes reproches. Je ne devais pas non plus être un malade très agréable. A l’inconfort, s’ajoutait la souffrance. Moi qui m’étais réjoui d’avance de redescendre en flânant à travers ce pays si intéressant que nous avions dû à l’aller parcourir sans perte de temps ! Cette joie même m’était refusée ».
Quant à la face sud, c’est vingt ans plus tard qu’elle fut gravie, par une équipe britannique dirigée par un certain Chris Bonington, cette masse de neige qui ressemble de loin à une boule de Chantilly que je contemple tranquillement un matin d’octobre depuis ma terrasse d’hôtel de Ghorepani.

De tels récits soulèvent quelques questions. Je me souviens vaguement de la « conquête de l’Annapurna » et de la gloire d’Herzog, même si je n’avais que trois ans. Je vivais alors en un lieu et dans un milieu à mille lieux de l’alpinisme et des montagnes, je me souviens d’interrogations de la part de mes parents, pourquoi font-ils cela ? A quoi cela sert-il ? Quand il y avait des accidents mortels, tout juste si l’on ne disait pas « qu’ils l’avaient bien cherché ». Cette idée de « l’inutilité » était bien établie, jusque dans le camp même des alpinistes, puisque Lionel Terray crut bon d’intituler son livre « Les conquérants de l’inutile ». Cela est symptomatique d’une époque (qui dure encore aujourd’hui, évidemment) où la pensée « économiste » a triomphé. Pas de valeur en dehors de l’utilité, dirait-on. Mais cela est faux. Je lis en ce moment le livre passionnant de l’anthropologue américain David Graeber (La fausse monnaie de nos rêves – vers une anthropologie de la valeur) qui dévoile à quel point ceci est faux, et combien dans de nombreuses sociétés, il est patent que la valeur n’est nullement associée « à l’utilité ». Encore faut-il savoir ce que l’on entend par « utilité ». Bien sûr, certains penseront que c’est trouver une utilité quand on augmente son prestige social ou même quand on augmente son estime de soi. Mais c’est alors jouer sur les mots, on ne compare pas le prestige ou l’estime de soi à une somme d’argent ou à une valeur économique quelconque. Depuis Mauss et son Essai sur le don, on sait qu’en beaucoup d’endroits du monde, on acquiert de l’autorité et du respect en maximisant ce qu’on donne et non ce que l’on gagne. L’art, l’alpinisme, sont deux domaines qui échappent ainsi au raisonnement économiste classique. On sera étonné peut-être que je dise « l’art » étant donné le coût des transactions sur le marché de l’art et la part de plus en plus importante prises par les marchands. Nous sommes, certes, dans une civilisation qui cherche à tout transformer en marchandise, mais la « valeur » qui en ressort, celle d’un Jeff Koons ou d’un Damien Hirst (pour citer les exemples les plus caricaturaux de cette marchandisation excessive) apparaît comme arbitraire, comme n’ayant rien à voir avec une valeur artistique réelle qu’on est, d’ailleurs, bien en peine de définir, si ce n’est par un maximum de désintéressement. Il en va de même pour la montagne : il est certes possible de « marchandiser » la montagne : ce qui s’est passé avec le mont Everest est éloquent à ce sujet, on « vend » le plus haut sommet du monde à de riches milliardaires qui seront prêts à intenter un procès à leur guide si le temps tourne au mauvais, les empêchant de gravir la pente mythique, mais cela n’a rien à voir avec le sens de l’abnégation et le courage de ceux et celles qui ouvrent des voies et gravissent les sommets. Il y a un sens du mot « valeur » qui reste à comprendre, semble-t-il tributaire seulement de la quantité de désir, de cette sorte d’inéluctabilité du désir qui naît de la simple confrontation avec un réel à la fois grandiose et hostile. C’est la difficulté(*) qui fait le prix de l’ascension des sommets disent certains, non, c’est le danger disent d’autres, mais dans un cas comme dans l’autre, ce ne sont jamais les retombées matérielles escomptables.
Autre question qui ne laisse pas que de m’intriguer : pourquoi sont-ce les occidentaux qui ont gravi ces sommets ? Comment se fait-il que ce désir inéluctable ne soit pas venu à l’esprit en premier de ceux qui habitaient leurs abords ? Certes, les mythologies des peuples himalayens leur interdisent de gravir ces sommets puisqu’ils seraient les habitats des dieux et déesses, mais cette explication ne me paraît pas suffisante. Difficile de croire qu’il ne se serait pas trouvé au moins un esprit fort ne croyant pas aux mythes, qui aurait tenté le coup (pensons à la « conquête de l’Amérique », qui aurait été faite – par les Vikings – bien avant 1492). Et puis quand il s’est agi de servir de sherpas à Herzog et Lachenal et à d’autres, les « locaux » n’ont pas rebroussé chemin au dernier moment, prétextant d’un interdit, s’ils l’ont fait, comme Ang Tharkey, c’était plus prosaïquement parce qu’ils sentaient leurs pieds en train de geler. Alors ? Qui possède une explication pour cette étrangeté ? Peut-être le désir de gravir les sommets, d’affronter ce réel à la fois grandiose et effrayant ne serait pas aussi universel ? Peut-être ne serait-il le produit que de certaines civilisations (ou modes de production, pour parler en termes marxistes ?). La montagne, décidément, nous plongera toujours dans un océan de méditation…
(*) il est intéressant de constater que les créateurs de la monnaie cryptée Bitcoin ont pensé justement à faire de la difficulté la contrepartie de la valeur de la monnaie : les « mineurs de bitcoins » sont des ordinateurs qui doivent résoudre un problème très compliqué afin d’assurer pendant le temps de calcul incompressible une garantie à la fiabilité de la monnaie émise.