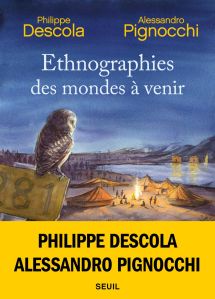Peut-on rêver d’un autre monde ? Là est sans doute la question obsédante, une question sur laquelle je suis revenu assez souvent sur ce blog, en faisant référence aussi bien à l’anthropologue David Graeber qu’aux philosophes Moishe Postone et Robert Kurz, ou à l’historien Jérôme Baschet. Dans la galerie des penseurs qui s’attellent à cette tâche, figure aussi le grand ethnologue Philippe Descola, professeur au Collège de France et auteur d’une thèse ayant bouleversé notre approche traditionnelle en matière d’anthropologie : Par-delà nature et culture. Les travaux de l’historien Baschet et de l’ethnologue Descola ont ceci de commun qu’ils nous montrent, chacun à leur façon et selon leur méthode, que le capitalisme n’est ni universel ni fatal, qu’il n’est pas l’aboutissement inévitable d’une évolution qui conduirait à une formation sociale définitive et sans alternative. L’humanité a pu vivre sous d’autres régimes à d’autres âges de l’histoire, elle peut encore vivre sous d’autres régimes dans certains endroits du globe et il n’est pas interdit de penser qu’elle pourra le faire un jour sur une bien plus vaste échelle. Cela ouvre la possibilité de rêver, d’imaginer de nouvelles solutions de vie en commun. Sur ce blog encore (1, 2, 3) j’ai fait usage de cette faculté de rêve et d’imagination en proposant une nouvelle en trois parties qui suggérait une solution pour un monde sans argent, un monde où l’on n’échangerait pas sur la base de la valeur et du travail abstrait mais sur celle des activités pures, l’activité dépensée dans tel ou tel but nécessaire à la collectivité étant à elle-même sa propre valeur, et ne donnant lieu à aucun « salaire » traduit en forme monétaire. Je dois dire que cette « utopie » n’a guère suscité de réaction, ce qui ne m’empêchera pas de la relancer bientôt tant je suis persuadé que nous avons besoin de scénarios alternatifs, de propositions vers d’autres organisations sociales afin de donner un sens à nos actions et à notre pensée. Peut-être ces propositions pêchent-elles parfois par leur négligence de tel ou tel aspect de la réalité, peut-être certaines sont-elles prises dans des contradictions passées inaperçues par leur auteur etc. etc. mais elles ont le mérite d’exister et d’ouvrir des débats qui, à mon avis, sont absolument nécessaires. Parmi eux, le débat sur la place de la science et de la technologie par exemple occupe une place essentielle (dans ma nouvelle, je m’inscrivais résolument dans une perspective où la technologie apportait des possibilités inexistantes sans elle, je sais que cela a été critiqué – les critiques m’ayant été faites oralement et non sur ce blog).

Philippe Descola ne fait pas autre chose que suggérer de telles rêveries positives dans l’ouvrage qu’il a co-écrit avec Alessandro Pignocchi, auteur de romans graphiques, et qui s’intitule Ethnographies des mondes à venir. Cet ouvrage, illustré de courtes histoires dessinées pleines d’humour, se nourrit des travaux de l’ethnologue dans la communauté Achuar (une communauté de l’Amazonie qu’il a abondamment fréquentée comme terrain d’enquête avant d’écrire sa thèse), mais aussi des observations que les deux chercheurs ont conduites dans ces nouvelles communautés qui apparaissent aujourd’hui parmi nous, les ZADs, et particulièrement celle de Notre-Dame-des-Landes. Descola a apporté son soutien à cette communauté et a manifesté toute sa solidarité avec certains mouvements qui en sont issus comme les Soulèvements de la Terre (et personnellement, je souhaite en faire autant). L’anthropologue a des conclusions qui rencontrent souvent celles que j’ai pu lire dans les écrits des philosophes cités plus haut, Postone et Kurtz (mais aussi il faudrait citer Scholz, Lohoff, Trenkle, Jappe ainsi qu’en France, Aumercier, Homs etc. tous rattachés au courant dit « de la critique de la valeur-dissociation »), tout en s’appuyant sur des hypothèses légèrement distinctes. Le courant Critique de la Valeur-Dissociation (désormais CVD) part de présupposés internes à l’oeuvre de Marx, même si celle-ci est l’objet d’une critique de fond (on distingue chez eux un Marx « traditionnel » d’un Marx qui serait profondément actuel, un Marx dit « exotérique » d’un Marx dit « ésotérique » et on s’attaque de front à un marxisme traditionnel basé sur la lutte des classes et le rôle indépassable du mouvement ouvrier), il met en avant les concepts de marchandise, de valeur, de travail abstrait et même de temps abstrait, comme étant des concepts qui priment par rapport à ceux de classe ou d’exploitation. Postone et Kurz tendent à montrer que c’est le Capital, en tant que « sujet-automate », qui est responsable de l’effondrement auquel nous assistons tant en matière climatique, biologique que social, on en déduit que la sortie du Capital serait le seul moyen de maintenir l’humanité en vie, et qu’elle suppose alors qu’on s’affranchisse des catégories de valeur (marchande), de monnaie et de travail abstrait. Descola, quant à lui, ne met pas le capitalisme à la source de tout, il ne le mettrait même que comme conséquence lui-même d’autre chose qui se situerait en amont, à savoir ce qu’il nomme le naturalisme. Ses lecteurs auront reconnu ici l’une des quatre ontologies qui, selon l’ethnologue, structurent la manière dont les humains conçoivent leurs rapports entre eux autant que les rapports qu’ils entretiennent avec le monde en général et particulièrement les non-humains. Le naturalisme est cette ontologie pour laquelle il y a discontinuité entre humains et non-humains (les animaux, les plantes…) : si humains et non-humains ont des traits communs quant à leur corporéité (ils sont tous faits de cellules et obéissent aux mêmes lois générales de la morphologie et de la biologie), ils se distinguent radicalement quant à leur esprit : seuls les humains ont un monde intérieur, seuls les humains ont un langage, seuls les humains ont des rêves. Cette ontologie leur permet alors de mettre à distance une partie de la réalité, qu’ils dénomment « la nature », ce qui leur permet de développer à son encontre une perspective d’étude à distance d’où découleront la science moderne mais aussi l’exploitation de ladite nature au profit propre des humains. La nature est alors vue sous l’angle de la ressource inépuisable, celle sur laquelle les grandes religions (le christianisme par exemple) mais aussi les grands philosophes (dont Descartes) commandent que nous exercions notre domination pleine et entière sur elle. C’est cette approche qui, selon Descola, fonde l’apparition du capitalisme. La symétrique du naturalisme, en tant qu’ontologie, serait alors ce qu’il nomme l’animisme, façon de voir les choses selon une perspective inverse : si au niveau des corps, la plus grande diversité régnerait, il n’en serait pas de même au niveau de l’esprit puisque toutes les espèces, aussi bien humaines que non humaines, partageraient les rêves, la vie intérieure, la faculté même de commander aux autres, au-delà des formes corporelles. Dans cette optique (qui est celle des Achuars), la notion de « nature » n’a plus de sens puisque tous les êtres (humains ou non humains) communiquent et peuvent avoir des droits les uns sur les autres. Il m’a souvent semblé apercevoir ce type d’ontologie au cours de mes voyages, elle serait certainement présente, je crois, dans la mentalité japonaise sous la forme sans doute de ce que les occidentaux voient avec mépris comme archaïsme mais qui pourtant, demeure vivace dans la vie de tous les jours. (Les deux autres ontologies, dont il sera en fait peu question, sont l’analogisme et le totémisme, caractérisées par les deux solutions restantes de la combinatoire s’exerçant au niveau des deux variables que sont : l’intérieur (l’esprit) et l’extérieur (le corps) d’une part et la dissociation / ressemblance de l’autre. Pour l’analogisme, diversité des corps et diversité des esprits avec associations par paires, pour le totémisme, unité des corps et unité des esprits pour peu que les deux appartiennent au même « totem »). On pourrait croire à une disjonction profonde de ces ontologies entre elles, or, Descola et Pignocchi prétendent qu’il n’en est rien, chacun garderait en soi de vieux fonds d’animisme même s’il ne souhaite rien en montrer, tout comme il est désormais possible de voir des Achuars ou autres peuples semblables se familiariser avec les sciences et les techniques en dépit de leur animisme primordial. La difficulté de la pensée de Descola tient à ce qu’elle pourrait être prise pour un relativisme, mettant sur le même plan connaissances scientifiques et croyances ancestrales, or, je ne crois pas qu’il en soit ainsi. Les deux auteurs ne semblent à aucun moment mettre en question la validité de la démarche scientifique (dont même, ils pourraient se réclamer puisque l’ethnologie a elle-même ses méthodes, que Descola respecte avec rigueur), tout au plus suggèrent-ils l’existence d’un hiatus entre la méthode scientifique proprement dite et l’import qui en est fait dans le but de valider des représentations qui ne sont pas, elles, scientifiques, mais plutôt teintées d’idéologie. L’absence de vie intérieure chez les non humains par exemple, si elle est souvent admise au nom d’une rationalité soi-disant scientifique n’a, de fait, jamais été prouvée scientifiquement. Les recherches en éthologie ont longtemps été cantonnées à des observations faites en laboratoire c’est-à-dire dans des milieux clos qui perturbent fortement les sujets observés. Depuis qu’elles s’en écartent en essayant de comprendre les comportements animaux dans leur milieu environnant, apparaissent des vérités étonnantes. Il ne s’agit donc pas de donner foi à des hypothèses extravagantes en s’éloignant des méthodes et des preuves, mais simplement de laisser la science à sa place, celle d’un processus matériel qui aboutit sans cesse à des découvertes que nous n’aurions jamais eu sans lui. Si l’avantage du naturalisme a été d’engendrer un tel processus, l’animisme a, quant à lui, d’autres avantages, comme le respect profond qu’il permet de maintenir à l’égard des autres espèces et des milieux dits « naturels ». Ainsi en explorant ses particularités, en vient-on à découvrir que, chez certains peuples, les rapports de possession s’inversent : les humains ne possèdent pas un territoire (avec toutes les « libertés » que cela leur donne de l’exploiter et de faire ce qu’ils veulent des non humains – et parfois des humains ! – qui le peuplent), c’est le territoire qui les possède. Ainsi, les ‘Are’are, habitants de l’île mélanésienne de Malaita, aux Salomons, disent-ils : « Les ‘Are’are ne possèdent pas la terre. La terre possède les ‘Are’are. La terre possède les hommes et les femmes ; ils sont là pour prendre soin de la terre ».
L’ethnologie et l’histoire, écrit Descola, nous offrent maints exemples de collectifs dans lesquels le statut d’humain est dérivé, non des capacités universellement attachées à leur personne, mais de leur appartenance à un collectif singulier mêlant indissolublement des territoires, des plantes, des montagnes, des animaux, des sites, des divinités et une foule d’autres êtres encore, tous en constante interaction.
Il est intéressant bien sûr de constater que se développent dans les ZADs des points de vue et des comportements similaires. Ainsi, disent les zadistes, « nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Philippe Descola écrit : « pour autant que j’aie bien compris ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, les occupants de la Zad n’exploitent pas un territoire dont ils aspirent à devenir propriétaires, ils accompagnent par leurs pratiques un milieu de vie qui a accepté leur présence ». En somme les zadistes ne s’installent et vivent sur un territoire que pour autant que celui-ci semble y avoir consenti ! On est là très proches en effet des pratiques décrites par l’ethnologue chez les Achuars qui, allant à la chasse pour quérir du gibier qui leur servira à se nourrir, entreront en conciliabules secrets avec les représentants de ces dits gibiers pour obtenir de leur part une autorisation à prélever quelques membres du groupe ! Cela pourra paraître absurde à tous ceux qui sont ancrés dans un naturalisme de base… comment obtenir une réponse des non-humains (dont on sait bien a priori qu’ils ne possèdent pas de langage au sens où nous l’entendons) ? Certes, mais le symbole est là. Nous ne savons pas vraiment comment les Achuars font pour obtenir cette autorisation, ce que nous savons c’est qu’ils la demandent et que, ce faisant, ils manifestent une attention et un respect incroyables envers les espèces qui partagent le même milieu qu’eux. Les zadistes ne dialoguent pas non plus directement avec les arbres, les espèces animales, les rivières ou les montagnes, mais ils organisent des assemblées générales ouvertes à tous les humains présents sur le site, « au cours desquelles ils débattent des affaires communes dans le cadre de « filières » représentant divers types d’associations avec des non-humains : la culture des plantes, l’élevage, la gestion de la forêt, les haies etc ». « Les intérêts propres du sarrasin, des brebis et des futaies s’accommodent ainsi par l’intermédiaire de celles et ceux qui ont la charge de les entretenir et qui doivent trouver des terrains d’entente pour que les non-humains dont ils sont, en quelque sorte, les mandataires informels, puissent faire valoir leur point de vue ». Comme on le constate, il n’est alors plus jamais question de rentabilité, ni de manière de monnayer un service, ni « d’exploitation » (en pensant à cette curiosité qui consiste dans notre langage juridique courant à avoir nommé en toute tranquillité un territoire « exploitation » parce qu’évidemment des êtres humains installés là « l’exploitent »!). C’est donc bien là, dans ce genre de zad, que s’expérimente sous nos yeux une manière de vivre en dehors du capitalisme. C’est bien sûr extraordinaire et la question qui se pose à partir de là est celle de savoir comment pourrait s’étendre un tel mode d’existence. Est-ce que nous pourrions à une échelle plus vaste vivre, subsister, maintenir un réseau de relations entre nous et avec les autres en dehors de tout rapport marchand ? Descola et Pignocchi sont prudents, il n’est guère envisageable de procéder à une « révolution » qui d’un seul coup convertirait notre monde à ces mœurs entièrement nouvelles… tout juste pourrait-on souhaiter qu’à force de multiplier des expériences de ce genre, elles deviendraient aisément accessibles à tous et toutes et que, même si beaucoup de personnes ne sont ni convaincues ni prêtes à vivre l’expérience, le fait qu’elles puissent fréquenter de tels lieux contribue à progressivement à leur changer le regard, et finalement à « changer la vie ».
[Dans un prochain épisode, je tenterai d’analyser de manière plus critique la proposition de Descola, en la rapprochant des travaux de la CVD et en allant peut-être plus loin quant à la question de l’argent. Dans le livre ici cité en référence, Alessandro Pignocchi répond à une question de Descola concernant l’usage de système d’échange local (SEL) en disant que le problème n’est pas l’argent lui-même, mais la commensurabilité généralisée (entre les biens) alors qu’évidemment il semble que les deux se
confondent : c’est l’argent qui permet cet « échange universel » néfaste et la moindre trace de sa subsistance dans une communauté, laisse redouter qu’il soit détourné de son but initial pour aboutir aux vices ordinaires de la marchandise : recherche de profit, thésaurisation, trafics en tout genre etc.]