Je n’avais pas encore lu son dernier livre lorsque j’ai vu Mathias Enard dialoguer à Morges avec Etienne Klein, car sinon, je lui aurais sans doute prêté plus d’attention. Etienne Klein ne l’avait pas lu non plus, comme il l’a confessé. Dommage que dans un débat de ce genre, chacun n’ait pas lu le livre de l’autre, le débat s’en trouve faussé, il n’y a d’ailleurs pas eu de débat sauf celui que tentait de faire exister un peu l’animateur, Schouwey, qui était très bon comme à l’accoutumée (je me souviens l’avoir vu excellent avec Christine Angot, pourtant la tâche était difficile). Donc tout le monde ignorait la place que jouent les mathématiques dans ce livre, et qui justifiait cette rencontre (qui avait pour joli titre : « équations littéraires et vies mathématiques »). Je ne connaissais de Mathias Enard que ses livres « Boussole » et « Zone » (encore que je n’aie lu le dernier qu’à moitié) où il faisait preuve d’une étourdissante érudition historique et littéraire sur les mondes de la Méditerranée, je ne lui savais pas une telle compétence en mathématiques, car pour parler d’Emmy Noether ou de la conjecture des nombres premiers jumeaux, inventer un mathématicien au cœur des débats de son époque qui, au cours de sa fuite du nazisme a dû passer par le camp de Gurs (clin d’oeil à Alexandre Grothendieck), il faut avoir quand même de solides connaissances en maths. Bravo. Tout ce qui permet d’instaurer un pont entre les sciences et la littérature mérite d’être salué. Nous en avons assez de cette séparation tenace entre les deux mondes, assez de ces scientifiques qui méprisent les littéraires et de ces littéraires qui se glorifient de n’avoir jamais rien compris, comme si cela pouvait être une gloire, comme si l’on pouvait tirer gloriole de son incompétence ou de sa paresse. Michel Serres écrivait (cité par Etienne Klein, p. 51) :
Les crises politiques que nous traversons sont fondamentalement épistémologiques. On construit, au nord de Paris, un campus Condorcet exclusivement consacré aux sciences humaines. Le campus Paris-Saclay, au sud, est principalement consacré aux sciences dures. Quelques dizaines de kilomètres les séparent. Cultivés ignorants ou savants incultes. La tradition philosophique était exactement l’inverse.
Et Klein écrit (p. 53) :
Militant hyperactif de la diffusion des connaissances, Michel Serres croyait dur comme fer en deux lois assez bien confirmées par l’expérience. La première : l’indifférence attachée par certains esprits à l’égard de tout ce qui a trait aux connaissances scientifiques ne fait pas d’elle-même souffler le vent de la pensée ; il ne suffit pas d’ignorer la science pour préserver la culture, ni de la dénigrer pour doper l’intelligence. La seconde loi peut s’énoncer ainsi : la possession de connaissances scientifiques de haut niveau ne constitue pas en elle-même l’assurance de bien penser ; en terrain difficile, même les esprits les plus aiguisés peuvent s’égarer.
Si j’en crois ma lecture de Déserter de Mathias Enard, les deux auteurs sont d’accord là-dessus. Il n’y aurait donc pas eu de débat de toutes façons s’ils s’étaient lus réciproquement ! La première loi est amplement manifeste dans le roman paru chez Actes-Sud : le mathématicien fictif inventé par l’auteur mêle des poèmes à ses théorèmes. Je crois toutefois qu’on n’a jamais vu cela en vrai, un mathématicien qui noie sa démonstration dans une élégie, même si d’aucuns ont écrit des textes hautement littéraires qui englobent des résultats plutôt ardus : on renvoie encore ici à Grothendieck et à son Récoltes et semailles (dont pourtant Enard dit du mal, trop répétitif, trop le témoignage d’un esprit paranoïaque), on pensera aussi à Jacques Roubaud pour qui j’ai une tendre affection, lui qui se dit « mathématicien en retraite et poète en activité », ce qui est de fausse modestie car il fut les deux en même temps (mais pas dans le même texte). La deuxième loi est toute aussi valide. La haute pensée mathématique ne dispense pas des erreurs de conduite, il est parfois difficile d’être clairvoyant : ce que nous montre Enard c’est ici un mathématicien fortement engagé dans le communisme pro-soviétique, celui de la RDA, ce qui ne peut hélas le conduire qu’à de profondes désillusions, qui ont pour nom construction du mur de Berlin ou coup de Prague, et qui se soldent par un suicide probable.
Dans le livre, deux dynamiques se font face, l’une concerne cette histoire, celle, racontée par sa fille, d’un mathématicien qui s’engagea jeune dans la lutte contre le nazisme et pour cette raison connut le camp de Buchenwald, prison au nom bucolique, à deux pas des lieux fréquentés et glorifiés par Goethe et Schiller, puis qui choisit l’Allemagne de l’Est par fidélité politique et idéalisme, l’autre, qui ne rencontre jamais la première, raconte la fuite désespérée d’un déserteur dans une montagne qu’on devine méditerranéenne (dans les Balkans probablement). Ces deux fils ne se rencontrent que dans la mise à distance qu’opère le lecteur : dans les deux cas, on est témoin d’une dévastation, celle du communisme, et celle causée par une guerre absurde, (bien sûr, comme elles le sont toutes). D’autant que la narratrice arrête son récit au moment où les troupes russes envahissent l’Ukraine. Il est donc question de Kiev et de Marioupol.

C’est à cela que sert la littérature, jamais à nous donner un produit fini, une leçon de morale ou de philosophie, mais juste un motif d’interrogation, qui, si possible, doit durer longtemps, le plus longtemps possible. Ajoutons à cela que le cœur de l’histoire contée par la fille, historienne des mathématiques de profession, qui connaît les nombres irrationnels de Nasiruddin Tusi (savant persan du XIIIème siècle), est un colloque qui doit réunir sur la Havel les principaux mathématiciens du début des années 2000 qui ont continué l’élan créateur de Paul Heudeber (c’est le nom de notre mathématicien génial). Ce colloque doit se passer sur le Beethoven, une péniche luxueuse. Les participants sont parcourus d’inquiétudes et de non-dits. Inquiétude justifiée : ils se retrouvent le 10 septembre 2001, autant dire que le lendemain, le colloque sera annulé et que chacun tentera de rentrer chez soi. Le Beethoven ne sombre pas, il est juste déserté, lui aussi. D’aucuns verraient là une métaphore de l’Europe.
Et les maths dans tout ça ? Pourquoi les mathématiques, comme demandait un ensemble de textes critiques des années soixante-dix paru chez UGE ?
Je me souviens de Jean Dieudonné, illustre mathématicien membre du groupe Bourbaki, intitulant un livre stimulant : « pour l’honneur de l’esprit humain ». Il reprenait une réponse de Jacobi à la question de ce pourquoi.
Point commun entre le livre d’Etienne Klein et celui de Mathias Enard : les deux réservent une place de choix à Emmy Noether, grande mathématicienne allemande, décédée en 1935, à qui l’on doit presque tout de l’algèbre moderne (groupes, anneaux et corps, idéaux d’un anneau etc.) et un théorème important pour les physiciens (qui montre la conservation d’une grandeur physique pour toute classe de transformations qui laissent invariantes les lois physiques), présentée dans Déserter comme la principale inspiratrice de Paul Heudeber. Il l’a connue lorsqu’il était enfant et qu’elle lui donnait chaque jour un problème à résoudre. Dans un documentaire sur les femmes en mathématiques tourné quelque mois avant la mort de Paul, lorsqu’on lui demande ce qu’il a appris d’Emmy Noether, mon père (gilet en laine grenat, veste en velours, moustache blanche), après une assez longue hésitation, face à l’objectif, répond de la voix fluette, un peu timide de ceux qui ne sont pas habitués à la caméra : tout – mais surtout à être généreux, à m’intéresser à autrui. La journaliste attendait une réponse mathématique, on la sent complètement désarçonnée par la phrase de Paul, alors elle insiste : et en mathématiques ? Que vous a-t-elle enseigné ? Paul prend alors son air pénétré […] elle m’a appris que les mathématiques étaient l’autre nom de l’espoir.
Réponses déconcertantes. Les mathématiques nous permettraient-elles en effet d’imaginer un monde enfin débarrassé de la douleur et des conflits ? On le sait, elle ne tolèrent pas la contradiction qui est la traduction formelle du conflit. Mais cette absence de contradiction n’est jamais acquise, elle est l’objet d’un travail incessant, quand un risque apparaît (comme ce fut le cas avec la découverte de la théorie des ensembles dans les années 1900) il faut creuser toujours plus profond afin d’établir de nouveaux fondements, lesquels eux-mêmes ne sont jamais assurés. Peut-être le mathématicien se dit-il que cela vaut mieux qu’affronter les conflits réels… En ce sens, l’espoir aurait partie liée avec l’illusion. Un univers uniquement mathématique ne ressortirait-il pas de l’illusion ? De cette beauté des formes en tout cas qui déjà à l’âge antique, enchantait Aristote.
Plus loin, dans une lettre d’amour adressée à sa femme Maja, dont il est séparé, il dit : Les mathématiques sont un voile posé sur le monde, qui épouse les formes du monde, pour l’envelopper entièrement ; c’est un langage et c’est une matière, des mots sur une main, des lèvres sur une épaule ; la mathématique s’arrache d’un geste vif : on peut y voir alors la réalité de l’univers […] Ce voile, cette nappe sur le monde, c’est aussi le linceul dans lequel je m’enveloppe quand vient l’heure du départ. Passage admirable. Cela apparaît plus lucide, et compatible avec cette idée de l’espoir comme illusion. Les maths dans ce cas seraient un voile de consolation.
Finalement, nous n’en saurons rien. Mathias Enard n’est ni un mathématicien ni un philosophe des mathématiques, il est juste un écrivain, un romancier qui prend les mathématiques au titre de sujet comme un autre, et les mathématiciens comme des personnages.
Reste la question de savoir pourquoi il se serait suicidé, lui, le mathématicien respecté, si le royaume des mathématiques lui était ouvert, havre éternel pour tous les désespoirs, voile consolateur à jamais étendu sur la dure réalité des choses et du monde ? Peut-être parce que ce royaume ne reste pas éternellement ouvert… les mathématiques nous échappent. Elles sont à une telle hauteur qu’elles deviennent inatteignables. Si on a été un bon étudiant en maths, puis un honnête professeur, si on a voulu un peu taquiner la recherche dans des domaines qui nous auront semblé abordables, on en aura fait l’amère expérience : ça résiste. Ça résiste de toutes parts, peut-être est-ce là justement que l’on fait le plus l’expérience du réel, c’est-à-dire de cette « matière » qui est délibérément en dehors de nous (paradoxe pourtant puisqu’il semble que les mathématiques ne dépendent que de notre esprit!) et qui n’obéit jamais à nos injonctions, qu’on ne saurait plier à sa loi ou à ses exigences. Que de souffrances endurées lorsqu’on croit avoir réussi à démontrer un théorème, que cela nous a pris des mois, des années, et que la tentative de preuve s’avère tout bonnement fausse. Que de tentations du suicide, auxquelles ont parfois succombé de grands mathématiciens (en 1958, le mathématicien japonais Yutaka Taniyama se suicida, par désespoir de ne pas avoir trouvé la solution du problème de Fermat), que de naufrages dans la folie. Ce ne semble pas être le cas de Paul dans le roman, en tout cas, sa fille ne nous en fait pas part, mais on ne sait pas. Les maths ne sont jamais un jardin de roses. L’esprit parfois s’effondre sous l’effort désespéré fait pour comprendre une conjecture.
Quant à l’autre personnage, celui qu’Heudeber ne croisera jamais, le soldat qui a fui le front pour se réfugier dans les montagnes, que nous aura-t-il donné ? Une leçon d’humanisme sans doute, quand il s’est retrouvé seul avec une femme qui, comme lui, tentait de s’échapper en compagnie d’un âne épuisé, et que, loin de l’avoir maltraitée, il l’a soignée. Puis il l’a sauvée des griffes d’autres soldats. Comme si la désertion était nécessaire pour nous mener vers un chemin de plus d’humanité. Déserter pour voir le monde humainement.

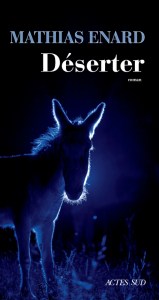

En vous lisant je me demandais si les mathématiques ne sont pas une forme d’art au même titre que littérature, poésie , électricité, maçonnerie et plomberie… Il me semble que le fil conducteur qui les rassemble est un besoin d’élégance qui ne s’obtient qu’au prix souvent couteux de laisser derrière soi une grande partie de ce soi justement. Que la mathématique exhume ou crée en nous un peu d’humanité véritable c’est ce que j’en pressens en tant que peintre pas du tout mathématicien mais traversant les mêmes dangers, les mêmes écueils.
J’aimeJ’aime
Oui, vous avez en partie raison: les mathématiques sont une forme d’art, surtout quand ce sont des mathématiques qui a priori n’ont rien à voir avec leur utilisation à des fins techno-commerciales. la différence toutefois réside dans ce caractère implacable de la preuve. Le mathématicien affronte toujours un Autre plus fort que lui: la sanction tombe toujours un jour ou l’autre: la preuve est correcte ou elle ne l’est pas.
J’aimeJ’aime
Je crois que c’est une manière d’approcher la réalité.J’ai eu la chance de croiser dans un moment critique vers 17 ans un brillant ingénieur grenoblois, qui m’a ouvert sur ce monde qui m’était fermé.L’école ferait bien de former ses professeurs aux dimensions peut être littéraires ou philosophiques des mathématiques.Un peu d’humanité dans les formations.
Comme disait Bachelard, un professeur ne comprend pas que l’on ne comprenne pas.Je n’ai pas rencontré dans le secondaire de professeurs sensibilisés à ces rapprochements.
J’aimeAimé par 1 personne
Très émouvantes, ces anecdotes sur la transmission vue par Paul Heudeber, l’apprentissage de la générosité, de l’espoir par les mathématiques. La consolation. Merci.
J’aimeJ’aime