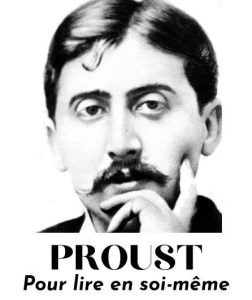On en revient au off (puisque les places du in sont si difficiles à obtenir!). On n’est pas déçu. Il faut louer ici le courage et le talent inouï d’artistes inconnus, souvent très jeunes, qui n’hésitent pas à se montrer seuls en scène munis d’un texte parmi les plus difficiles appris par cœur. Parfois textes d’eux-mêmes, d’autres fois textes écrits par d’autres parmi les plus grands (Proust, Woolf, Duras…). Dans les premiers, performance éblouissante, au Théâtre des Halles, accomplie par Frédérique Voruz, auteure de son propre texte, Lalalangue, où il est question d’elle bien sûr, mais surtout de sa maman et ses névroses, agrémentée de vieilles diapos projetées qui la montrent, la maman, mais aussi la petite Frédérique en son jeune âge, et le papa un grand benêt d’ingénieur se parlant perpétuellement à lui-même (ou aux arbres). La petite Frédérique n’a pas eu de chance : sa mère, des années avant qu’elle ne naisse, a eu un grave accident d’escalade en compagnie de son père, elle y a perdu, outre les jumeaux dont elle était enceinte, une jambe (le père lui n’a eu qu’un bras cassé). Triste pour une fana de montagne. Mais déclara-t-elle à la sortie de son coma : « Je me vengerai sur les enfants ». Elle en eut huit. Frédérique nous parle de son doux moignon, peut-être la seule chose douce qu’elle avait en elle. Pour le reste, c’était rigueur, avarice et torture mentale. L’autrice seule en scène n’a pu s’en sortir que par une psychanalyse dont elle nous mime les mouvements avec humour (« on s’arrête là » dit la praticienne en secouant la cendre de sa cigarette en fin de séance). Pourquoi Lalalangue ? Parce qu’il s’agit, on l’a compris, de lalangue et non pas de la langue, au sens où Jean-Claude Milner, dans L’amour de la langue, dit ceci : « Il y a d’une part la langue, comme entité objective, qu’on peut décrire et même formaliser ; il y a d’autre part cette langue où l’être parlant inscrit son désir, son inconscient, sa subjectivité. Elle ressemble à la première ; en fait, du point de vue matériel, elle en est indistinguable, mais elle se déploie tout autrement : dans les jeux de mots, dans la poésie, dans les homophonies. Pour rendre compte à la fois de la ressemblance matérielle et de la différence radicale, Lacan avait forgé en un seul mot : lalangue ». alors ce qui est drôle ici, bien sûr, c’est que de ce mot bizarre et sans article (lalangue), Frédérique Voruz fasse un nouveau nom de la langue française : La lalangue, mais alors pourquoi pas Lalalangue et ainsi de suite…

Ce seule en scène de Frédérique Voruz a déjà connu les feux de la rampe, il est passé à la Cartoucherie, adoubé donc par Ariane Mnouchkine qui y a vu une « confession héroïque », il est mis en scène par Simon Abkarian qui est aussi l’auteur de la préface du livre. On pourrait presque dire que le texte est un condensé de psychanalyse lacanienne, semblable aux compte-rendus d’analyses que publiait Freud, mais évidemment en plus drôle et en plus « parlé ». Il est probable que beaucoup de spectateurs, surtout des spectatrices d’ailleurs, se reconnaissent, s’identifient dans cette histoire. Il suffit sans doute d’avoir eu une éducation religieuse, ici catholique mais je connais des protestant(e)s qui ne voient pas la différence. Il faut toujours souffrir pour gagner son paradis, il faut se priver de tout (« la privation est une jouissance »), et lorsqu’il s’agit de nourriture, cela donne : « manger de la merde en ayant sous les yeux une chose savoureuse interdite était pour ma mère la plus belle des jouissances ». A la fin, la petite Frédérique étouffe, elle est tout le temps surveillée, sa vie pourrait s’étioler comme une fleur qui n’aurait plus eau ni lumière, si le temps de l’analyse n’arrivait pas. L’analyste est une femme « très digne et très drôle ». Elle croise les jambes comme pour dire : « j’en ai, moi, des jambes, n’essayez pas d’être ce qui me manque ». Car on n’est pas là pour se lamenter ou pour pleurer sur des manques, on est là pour « démanteler une position inconsciente ». « En psychanalyse, dit Frédérique Voruz, on dit qu’on a toujours la vie dont on rêve, du moins inconsciemment. Il s’agit donc de mettre en lumière quelle zone cachée jouit d’une situation qui nous rend consciemment malheureux ». Et nous aurons la « réponse », l’aboutissement sous la forme d’une reconnaissance enfin d’un amour réel caché sous tant de mots blessants, l’élucidation d’un mystère : pourquoi vouloir être sa vie durant la jambe qui manque, se mettre sous le moignon, « je ne voulais pas qu’elle tombe. Mais qui de nous deux serait tombée ? C’est moi qui finalement ne savais plus comment tenir debout, comment me connecter au monde. Il me fallait un corps auquel me raccrocher le temps de me reconstruire ». Alors, on voit que la jeune Frédérique a désormais les moyens de s’ouvrir un chemin hors des décombres et des moisissures (dont sa mère s’obligeait à se nourrir). Ariane Mnouchkine. Le théâtre etc. C’est donc un magnifique spectacle que nous avons vu en ce 18 juillet, d’une psychanalyse incarnée – le mot n’est pas trop fort – dans une voix et un corps de jeune actrice enfin arrivée à ce qu’elle voulait.
Parmi les diseurs de textes de grands auteurs, Il y eut Olivier Barbéri qui, à la Chapelle de l’Oratoire, disait les vingt-cinq dernières pages du Temps retrouvé, dans Proust pour lire en soi-même. Une jolie prouesse de la part d’un passionné de Proust. Certes, il n’est pas Podalydes, qui, la semaine d’avant, nous faisait exploser de rire dans son numéro d’imitation des vieilles duchesses reçues chez les Guermantes, mais son phrasé pointilleux mettait l’accent sur les principales remarques philosophiques concernant le temps que contiennent ces dernières pages. Proust, déjà arrivé à un âge avancé, se demande comment il pourrait écrire ce livre qui lui permettrait enfin de ramasser en une œuvre tous les moments vécus au cours de sa vie, tant du côté des Guermantes que de celui des Verdurin, tous ces moments précieux qui, à la fin de sa vie – aussi bien que de la nôtre, puisque nous en sommes tous là – se pressent en lui pour constituer la somme immatérielle et miraculeuse de ses – de nos – souvenirs ? Il faut remercier ce monsieur Barbéri de nous avoir fait méditer à cette approche du temps. A la fin de son seul en scène, il nous parle aussi d’un aspect de Proust que l’on néglige trop souvent, ses engagements. Bien sûr en faveur de Dreyfus, mais aussi à propos de la séparation de l’église et de l’état.
Et puis, toujours parmi les textes venant d’auteurs qui ne sont pas l’acteur ou l’actrice, il y eut Emilie Faucheux interprétant si bien l’anthropologue Nastassja Martin en dialogue forcé avec un ours de Sibérie, dans Croire aux Fauves, au théâtre Présence Pasteur. Une femme seule en scène encore une fois mais dans des effets de lumière troublants et avec un accompagnateur sonore (Michaël Santos) qui savait restituer toute l’angoisse des forêts la nuit quand y rôdent loups et ours… J’ai déjà parlé sur ce blog du magnifique livre de Nastassja Martin. Emilie Faucheux en exprime toute la force comme si elle vivait elle-même cet affrontement décisif sur scène, face à ses spectateurs.