A la suite de deux de mes précédents articles, on pourrait se demander comment résoudre le lien entre science et système historico-social, ou, pour le dire tout à fait autrement mais selon les termes de mon interlocuteur Wonja Ebobissé, comment il se fait que « le sujet humain étant un produit dérivé et toujours en évolution de la nature, cela ne l’empêche pas de l’analyser et de la comprendre ». On peut être surpris ici par le rapprochement que j’opère de ces formulations, c’est bien sûr que je conçois ce « sujet humain » comme émanant d’une structure historique et sociale qui, en dernière instance, a place dans « la nature », mais en dernière instance seulement. Sur la deuxième partie de la phrase, sur analyser et comprendre cette nature, il faudra peut-être se résigner à penser un jour que ledit sujet humain n’y arrive pas si bien que cela et que ce qu’il prend pour une analyse parfaite du monde extérieur n’est qu’une exploration des propres structures qui le maintiennent, lui, le sujet. Cela permettrait alors, entre autres choses, de résoudre le problème, posé par Wigner, du caractère incompréhensible du fait que les mathématiques parviendraient à expliquer le monde (précisément : « l’effectivité déraisonnable des mathématiques dans les sciences de la nature »).

Qu’il y ait un lien entre la science et le système historico-social par le biais des structures mentales, cela apparaît clairement chez des physiciens modernes comme Carlo Rovelli, avec la façon dont ils conçoivent la science et les phénomènes qu’elle étudie. Selon eux, la physique est le lieu où l’imbrication entre la structure de la réalité et les structures de la pensée paraît aujourd’hui la plus étroite. Les mathématiques n’ont même pas besoin de postuler l’existence de structures du monde extérieur. Elles sont la pensée en action et on ne s’ébahit devant leur beauté et leur puissance que pour mieux s’émerveiller de la puissance de notre esprit. On voit au travers elles comment l’esprit fonctionne, et on ne trouve rien d’étonnant finalement à ce que des psychanalystes s’en inspirent pour mieux penser l’inconscient (Alain Connes en dialogue avec Patrick Gauthier-Lafaye, par exemple), ou d’autres pour mieux penser le temps dans toute son épaisseur topologique (Daniel Sibony). Mais la pensée n’est pas un vague éther où se dissolvent les idées évanescentes, elle ne tombe pas du ciel, elle est inscrite dans du matériel, du concret. Concret de nos corps, de nos organes, mais aussi de nos rituels sociaux, de nos institutions, de nos pratiques et de nos habitus. La pensée est dans l’histoire. Et donc physique et mathématiques sont aussi dans l’histoire et reçoivent d’elle des déterminations qui passent bien sûr inaperçues, mais n’en existent pas moins. C’est le propre du fétichisme de la pensée de nous faire croire qu’il n’en est rien. Par fétichisme de la pensée, j’entends ici la même chose que le fétichisme de la valeur tel que décrit par Marx : nous sommes à l’origine d’un processus, et pourtant il fait partie de ce processus de nous persuader qu’il n’en est rien, qu’il existe par lui-même, inscrit dans la nature, dans un monde extérieur qui n’est peut-être même pas atteignable. D’où la nécessité d’inventer des dispositifs théoriques sous forme de couples : noumène / phénomène, sujet / objet ou corps / esprit. Mais si nous avons suivi l’argumentation de Rovelli à propos de l’interprétation relationnelle de la physique quantique, nous voyons bien que ces dichotomies sont artificielles, Russell parlait déjà d’une indistinction entre interactions physiques et interactions mentales. La dichotomie sujet / objet disparaît en physique quantique. Et il est admis désormais par la philosophie contemporaine (Jocelyn Benoist après Jean-Paul Sartre) qu’il n’y a que des phénomènes, excluant toute idée d’un « réel caché ».
Réfléchir au lien avec la structure sociale-historique s’impose donc. Cela aurait dû être le cas de la réflexion marxiste, mais elle est demeurée floue, pour ne pas dire pire, quant à son rapport à la science, et encore plus, dirais-je, quant à son rapport aux mathématiques et à la logique. A part quelques considérations générales de Marx et Engels sur la dialectique qui serait partout à l’oeuvre dans la pensée s’illustrant par des couples d’opposés (plus – moins, multiplication – division, dérivation – intégration etc.) qui seraient comme la thèse et l’anti-thèse avant qu’ils ne se rejoignent dans une synthèse dialectique, on ne trouve pas grand-chose. C’est maigre, et ça laisse entendre que la réflexion scientifique serait un simple reflet de l’ordre « naturel ». On y admet tacitement la notion de sujet de la science, c’est-à-dire d’un sujet transcendantal à la façon kantienne.
L’apport de Kant aura été, en affirmant le rôle actif du sujet, de rendre possible la connaissance sans recours à un rapport mystérieux entre l’esprit humain et la réalité extérieure, certes, mais quid de ce sujet, n’est-il pas aussi mystérieux ?


Walter Benjamin et Asja Lacis
Il aura fallu attendre les années quarante à soixante pour qu’un auteur peu connu se penche sur la connexion à établir entre Kant et Marx. Cet auteur est Alfred Sohn-Rethel, qui a travaillé dans l’ombre pendant presque toute sa vie. Admirateur de Theodor Adorno et influencé par l’Ecole de Francfort, c’est au cours des obsèques d’Adorno qu’il parvint à convaincre l’éditeur de ce dernier de l’éditer à son tour. Ses travaux, même encore non publiés, avaient attiré l’attention auparavant de Walter Benjamin, qui était son ami. L’un des livres que l’on trouve actuellement sur le marché est d’ailleurs un petit texte à plusieurs voix sur Naples qui réunit Walter Benjamin, Asja Lācis et Alfred Sohn-Rethel. Asia Lacis était la muse de Benjamin, celle qui essaya à plusieurs reprises d’attirer le philosophe allemand à Moscou. On trouve chez Benjamin, notamment dans son dernier ouvrage, Le concept de l’histoire, des remarques qui portent la marque de son interaction avec Sohn-Rethel. On sait que Benjamin résista à tout enrôlement au sein du Parti Communiste, comme il refusa de répondre aux appels de son grand ami Gershom Scholem de le rejoindre à Jerusalem. La pensée de Benjamin, comme l’écrit mon ami Jean Caune, gravite autour de deux foyers sans jamais rejoindre ni l’un ni l’autre : le marxisme, qu’on appelait à l’époque le matérialisme dialectique, et le messianisme juif. On sait aussi que, rejoint par la vague nazie, il tenta de fuir vers l’Espagne en 1940, et y échouant, préféra se donner la mort. Je raconte tous ces faits pour mettre en place un cadre, mettre un contexte à tout cela.
Peu d’ouvrages de Sohn-Rethel sont accessibles en français. Anselm Jappe a écrit une intéressante préface à La pensée-marchandise, intitulée L’argent nous pense-t-il ? Pourquoi lire Sohn-Rethel aujourd’hui ? et le philosophe-logicien Jean Lassègue a écrit également une recension sur un article important : Geistige und Körperliche Arbeit, Zur Theorie der gesellschaftlichen Synthesis, qui a été traduit par : Travail intellectuel et travail manuel, une critique de l’épistémologie.
Evoquant à l’instant la notion de fétichisme dans le domaine de la pensée, pour dire que le fétichisme de la pensée était ce processus par lequel celle-ci nous apparaissait comme une substance donnée, il semblait naturel de faire le rapprochement avec un fétichisme semblable, celui de la valeur. C’est ce rapprochement, pour beaucoup de gens inattendu, auquel se livra Sohn-Rethel. Pensée, valeur. Une certaine forme de la pensée apparaît dans la Grèce antique : elle conduira à notre philosophie (mais aussi à nos sciences, mathématiques surtout). Je me permets de penser que ce n’est pas que là : des formes de pensée apparaissent ailleurs, un peu en même temps, de manière synchrone, on fait de Nagarjuna un contemporain d’Aristote. Elles sont contemporaines d’une apparition ou d’une généralisation de l’échange : on ne se contente plus de ce que l’on produit soi-même mais pour acquérir d’autres choses produites par d’autres, on est prêt à échanger, et même pour cela, à user d’une nouvelle denrée spécifique : la monnaie, entité singulière et incroyable au premier abord car c’est une réalité concrète en même temps qu’une abstraction totale car elle suppose tout un cheminement intellectuel conduisant à reconnaître dans deux objets totalement différents, n’ayant ni la même fonction ni le même usage, pourtant une constante, un invariant : avoir la même valeur, pouvoir s’échanger l’un contre l’autre. Autrement dit, c’est une abstraction-réelle. De ce genre d’entité qui structure notre champ de conscience et qui fait naître authentiquement un rapport social. Comme on le voit, Alfred Sohn-Rethel s’en tient à la circulation des marchandises, elle lui suffit à poser les concepts de valeur d’usage et de valeur d’échange, alors que, chez Marx, on introduit en plus la valeur travail, c’est ce qui lui sera reproché par la suite, notamment par Robert Kurz et les autres dignitaires de la CVD. Ce n’est pas ici le lieu de trancher pour savoir qui a raison et qui a tort : il apparaît que Sohn-Rethel, en se limitant à la notion de valeur d’échange définie à partir de l’abstraction de l’échange, a déjà suffisamment de grain à moudre. On peut noter ici que, dès qu’existe l’échange, peut se produire le phénomène de la division du travail. On n’est pas obligé de produire soi-même pour vivre. On peut aussi déployer des activités qui seront vues par les producteurs comme tout à fait équivalentes à du travail et produisant des biens d’un autre ordre (religieux par exemple) même si elles ne sont pas immédiatement productives. Il y aura ainsi des gens pouvant s’abstraire du travail immédiatement productif, c’est-à-dire du travail manuel, et qui se livreront à l’échange en même temps qu’ils développeront des idées, des pensées, des concepts, des objets de croyance ou d’admiration, autrement dit du travail intellectuel. La pensée, dans ce contexte, apparaît à la fois comme une réalité de nature semblable à la monnaie, c’est-à-dire une abstraction grâce à laquelle peut se déployer tout un monde d’échange, et comme une réalité rendue possible par, justement, le type de processus engendré par l’échange monétaire, à savoir la division du travail. Sohn-Rethel est plus précis que cela, il dit, dans le texte dont Jean Lassègue fait la recension :
La véritable abstraction inhérente à l’échange ne devient perceptible que dans la monnaie frappée. Dans toute pratique commerciale antérieure encore compatible avec les formes communautaires de société (d’ailleurs on trouve des vestiges de telles formes dans tout le pourtour méditerranéen proche et oriental), la véritable abstraction était, bien sûr, tout aussi opérante, mais d’une certaine manière, totalement dissimulée à l’esprit humain. L’introduction et la diffusion de la monnaie ont cependant supplanté la production communautaire et inauguré une forme de synthèse sociale ancrée dans la « réification », ainsi nommée car le contexte social des individus se transforme en contexte social de leurs produits, communiquant entre eux dans les termes monétaires des prix, leur « langage marchand », selon l’expression de Marx.
Cet usage de l’expression « langage marchand » attribuée au grand Karl, me fait inévitablement songer que la question même du langage se trouve posée au travers de ces considérations et… que je ne dois pas être le premier à l’avoir pensé1.
1 Une courte recherche me montre que ce même Jean Lassègue a justement produit en compagnie d’un linguiste, Yves-Marie Visetti, et d’un anthropologue, Victor Rosenthal, un article autour de cette question.

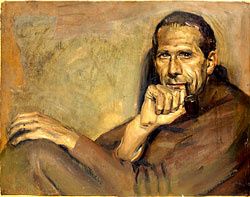
Merci pour ce billet très intéressant ! Je ne connaissais pas Jean Lassègue, et je vais m’empresser d’aller y voir de plus près. Quelques points :
(1) Pour le « Problème Wigner », je reste convaincu qu’il reste mal posé (après lecture express de l’article de l’auteur). Pourquoi sommes-nous si surpris que les mathématiques décrivent (en partie) notre monde, et pas nos langues ? Les mathématiques sont un langage, et donc il ne devrait pas y avoir de surprise particulière qu’elles puissent décrire notre monde. En tout cas, ce n’est pas plus surprenant que de constater que la phrase « Cette personne a une allure altière et discrète » décrit une personne telle.
(2) Ce « miracle » de l’adéquation est somme toute relatif. C’est le mathématicien Pierre Lochak (dans Mathématiques et finitude) qui rappelle qu’un mathématicien n’arrive pas à « décrire » (modéliser) le mouvement des cercles d’une tasse de café lorsqu’on y agite sa cuillère. De même, on n’a toujours pas (malgré une formidable quantité d’efforts) de modélisation adéquate d’un nombre immense de phénomènes courants. Au hasard, les évolutions des bulles financières. Cela incite à une certaine modestie (en dépit des prouesses formidables des sciences).
(3) Paradoxalement, Connes qui n’aime pas la thèse qui déclare que « les mathématiques sont un langage » est pourtant quelqu’un qui rapproche les mathématiques de la poésie, car l’imagination (l’invention) est fondamentale. Or pourquoi n’apprécie-t-il pas cette thèse ? Parce que les mathématiques parleraient d’une réalité aussi fondamentale que la réalité concrète que nous connaissons. C’est là le paradoxe (sinon la contradiction) : la poésie est l’exemple même d’un usage non-descriptif (non-déictique ?) du langage. Alors pourquoi serait-ce si choquant que le langage mathématique ne désigne aucune réalité mystérieuse particulière ? Le coût épistémologique de la croyance en des « réalités mathématiques » indépendantes du langage et de la matière est proprement infini (comme la croyance en l’existence du montre du Lochness) tant qu’on ne rattache pas ces réalités mathématiques aux structures fondamentales de la matière.
(4) Au final, ce « miracle de l’adéquation » m’apparait tout bonnement théologique – et d’ailleurs l’auteur finit sur le trope classique du « mystère ». Je crois que les démarches comme de mathématicien comme Gilles Dowek (Les métamorphoses du calcul) sont plus cohérentes. Elles reposent certes sur des thèses non démontrée (la nature comme machine à calculer), mais qui sont tout de même plus étayées (car nous et nos ordinateurs pouvons faire des calculs).
J’aimeJ’aime
Dire que les mathématiques sont un langage (et que donc, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’elles décrivent le monde) ne me parait pas suffire. Il faut d’abord savoir ce qu’est un langage et il se trouve qu’un langage n’est pas simplement un décalque de la structure de l’étant. C’est là avoir une notion complètement dénotationnelle (ou référentialiste), or le langage ne fonctionne pas comme ça, la phrase « Cette personne a une allure altière et discrète » ne décrit pas une personne comme telle, mais la désigne éventuellement et en fonction de conventions largement pragmatiques, à moins qu’on est une définition « dénotationnelle » précise des mots altier et discret, ce qui est loin d’être le cas!. Bonnes vacances!
J’aimeJ’aime
Vous faîtes bien de me reprendre ! Je crois qu’avoir une position non complètement dénotationnelle du langage mathématiques permet de se passer du platonisme.
Bonnes vacances !
J’aimeAimé par 1 personne
La vraie jeunesse ne s’use pas. On n’a beau l’appeler souvenir, on a beau dire quelle disparaît, on a beau dire vouloir dire que tout s’en va, tout ce qui est vrai reste là. Jacques Prévert. La vie n’a pas d’âge.
Il est bien facile, pour celles et ceux disposant du plus que le nécessaire à vivre de faire des leçons de morale aux précaires et familles vivant sous le seuil de pauvreté n’ayant qu’accès difficile à logement décent dont le loyer bouffe, dans les grandes villes de certitudes économico-financières, jusqu’à la moitié d’un SMIC.
Il est bien commode pour ces clans et groupes de ‘’hautes volées’’ ne voulant jamais se regarder dans le miroir des contre-mesures d’ériger aux classes ‘’inférieures’’ les bienfaits du ‘’lâcher prise’’, comme seule issue où, parfois, les anciens compagnons de route assènent les derniers outrages envers ce goût de vivre bien, dans le monde d’ici, et que l’obsessionnelle fourberie passionnelle ignore.
Ceux-là doivent être personnages à peu de bonnes et utiles recommandations universelles, mais surtout des individus dopés à une prétention telle qu’elle doit leur faire oublier les bases sociologiques de l’échange de bons alois comme les règles de vie collectives relativement équilibrée. Malheureusement la spéculation envers l’impossible principe de subsidiarité entre esprit et matière est devenu la norme des sociétés ‘’modernes’’, avec, dans cette déstructuration anomique et prédatrice, tous les dommages collatéraux imaginables, éliminant tout ce qui n’est pas conforme à la taylorisation ambiante et partiellement induit par des experts, néo-logiciens et politiques paradoxales, tels de pseudo docteurs en toutes matières.
Je n’aime pas l’humanité, dans sa généralité formatée aux pensées grégaires, omnipotente, mais j’apprécie, de temps en temps, la singularité humanisante de certains de mes congénères, notamment celles et ceux ayant, de par leur propre expérience dans le monde réel, appris l’humilité. Par-contre, gente d’items en néfaste pudibonderie serez-vous capables de vous approcher de la bienveillance suffisamment éloignée des illusions comme pouvoir sortir de vos veules invectives n’ayant à cœur qu’idées complotasses, envers autres que vous-mêmes, désaxées par quelques clans de Méphistophélès se foutant royalement de vos affres calqués à la bassesse de néologismes fort proscrits de la bienséance.
Ces illusions de vous-mêmes vous rendent immanquablement faillibles. Vous vous voyez grandiloquents personnages alors que vous n’êtes que de petites choses narcissiques. Vous voulez être heureux, à n’importe quel prix alors que votre misérabilisme usurier n’est que fourvoiements de votre quotidien. Vous croyez être parfait alors que vos pensées ne sont qu’aveuglement induit aux seules bornes de votre égocentrisme. Vous êtes sûrs de connaître la ‘’vérité’’ – par-delà notre monde – alors que vous êtes prêts(es) à vendre vos postures incertaines à n’importe quel guide de malheur ou néo-coaching de pacotilles.
Et pourtant, penser l’humanisme ce n’est pas remplacé le monde actuel par des paradigmes sans fondements quant au réalisme de la grande scène physique, biochimique, biologique et virtuelle de nos frêles existences mais rendre son évolution positive et potentiellement respectueuse du et des biens communs actée par le véritable sens des capacités humaines à les préserver sans manquer d’imagination en faveur de quelques transformations adéquates à la variation du processus statutaire de notre auto-transformation attachée à la liberté d’action personnelle et collective au nom de la préservation des biosystèmes terrestres comme de l’accessibilité à zones de confort dignes… Pour tout à chacun et chacune sans distinction de couleur, de race, de religion, d’ethnie et de classes sociales-économiques et financières.
En effet, comment-vous y prendrez-vous de vos anciens « canons » comme des nouveaux à les braquer contre notre démonstration d’existences estimables sur ce qui est de notre bonne nature à ne point se soustraire d’une probité sociétale comme il pourrait en être d’une textualité versée à bienséance ?
Le réveil vient de sonner. Vous êtes encore au lit. Vous avez deux solutions :
C’est du virtuel, du possible, de l’imaginaire ou du réel… ?
Le ferez-vous ?
Plus grand monde dispose d’assez de calme et de réflexion pour s’intéresser aux mots perdus dans les chapitres de quelques livres. Le défilé continuel des images sur fonds d’écran est devenu le maître du temps asservissant de piètres en viles besognes les sujets pressurisés à la réalité des objets du monde. Héritage d’us et parures sorti d’un népotisme fourbi à mémoires hors-sol… ? Les ‘’politiques’’ du monde jouent un funeste jeu d’avec histoires alternatives. Le genre humain ; de type mâle ou femelle, est-il une curieuse composition entre mots (maux) paradoxaux, afin de…, pouvoir ; peut-être, aller jusqu’à disloquer la nature et démembrer son propre univers…
La philosophie politique d’Hannah Arendt échappe aux catégories traditionnelles de la pensée politique (socialisme, libéralisme). Elle aborde un ensemble de problématiques variées, dont celles de la révolution, du totalitarisme, de la culture, de la modernité et de la tradition, de la liberté, des facultés de la pensée et du jugement, ou encore de ce qu’elle désigne comme la « vie active », et ses trois composantes que représentent les notions qu’elle forge du travail, de l’œuvre et de l’action.
C’est notamment au travers de la distinction qu’elle opère entre ces trois types d’activités que ressort l’un des axes centraux de sa réflexion, concernant ce qu’est la vie politique et la nature de la politique, thématique qu’elle aborde sous un angle largement phénoménologique, influencé en cela par Heidegger et Jaspers. La réflexion politique d’Hannah Arendt, appuyée sur la question de la modernité, c’est-à-dire de la rupture du fil de la tradition, l’a amenée à prendre position sur le monde contemporain, notamment sur des sujets très polémiques, comme le sionisme, le totalitarisme et le procès d’Adolf Eichmann. Ces prises de position ont grandement contribué à sa célébrité. Elle s’inspire cependant aussi de nombreux autres penseurs pour construire sa philosophie, parmi lesquels Aristote, Augustin, Kant, ou encore Nietzsche.
Par conséquent un combat universel contre le déterminisme impérieux qu’il soit politique, philosophique, économico-financier ou de type déculturé. Déterminisme politique, philosophique, économico-financier ou populiste ; quelles sont dignités suffisantes pour plaire aux bourreaux… comme aux tyranniques et aux impérieux ???
Si la tendance et l’intention ultime de la TRAGÉDIE consistent à se tourner vers la résignation, vers la négation de la volonté de vivre, alors il serait aisé de reconnaître dans son opposé la COMÉDIE comme l’exhortation à poursuivre l’affirmation de la volonté. Paradoxalement, si la tragédie de l’homme est celle de se multiplier à l’infini dans un monde NATUREL fini, alors la théorie d’une sélection par l’intelligence rationnelle devrait être, dans l’avenir, proche, la nouvelle ère profitable à un nombre décroissant ayant plus grande probabilité de survie.
Tel un ensemble (E) – de machines humaines – cherchant à se débarrasser du fardeau que l’idée du destin ou du hasard aurait forgé sur les épaules de l’homme s’inoculant l’absurdité à retransmettre, indéfiniment, une volonté existentielle dominante croissante consistant en l’expression de la tragédie comme l’impression de l’Idée la plus élevée de l’histoire, l’incitant à se rapprocher de la résignation, voire du négationnisme, dans une incompréhension, presque totale, entre volume, masse et tropisme factuel lié à un communautariste langagier défini au maux d’un verbalisme catégoriel.
La réémergence ‘’moderne’’ des potentialités d’équilibre entre effet malthusien et théorie darwinienne fera, certainement, le reste. A moins que dame nature ne puisse, avant la fin de la tragi-comédie humaine, plus maintenir, les conditions Utiles, Nécessaires, Indispensables et Essentielles au vivant ; et ainsi à ce que le champ terrestre deviennent l’aire d’une lutte à mort pour la survie – aléatoire – d’une partie de l’espèce humaine.
La recherche du superflu donne une plaisante excitation, plus grande que l’acquisition du nécessaire. L’homme est une création du désir, non pas une création du stockage.
Le bonheur, n’est pas un idéal de la raison, c’est un idéal de l’imagination, par la vision de la totalité des satisfactions possibles… Où le murmure entre les sciences et les arts ne saurait, en aucun cas, être une contrainte à l’étude des pensées d’autres temps, analyse et compréhension de divers savoirs, connaissances et cultures…
Freud définit comme interférences spécifiques du fonctionnement de l‘inconscient les caractères suivants : ignorance de la négation et de la contradiction et indifférence à la réalité – l’inconscient est soumis au principe de plaisir (le principe de réalité étant une caractéristique du moi) – ; comme déroulement d’un processus primaire. Les investissements des affects sont libres et non liés à des objets déterminés, par opposition au système conscient. S’y greffe le fait que la temporalité de l’inconscient n’est pas celle du déroulement chronologique, mais s’appuie sur les différences d’intensité et sur « l’après-coup » : c’est après coup qu’un évènement passé est saisi comme évènement, potentiellement, important et chargé de signification…
Pas penser, pas panser,
Sale bête éructant les vieux mots infâmes,
Ceux qui n’ont de noms que les plus fourvoyés,
Petit homme sectaire branlant sous sa propre bave,
Immatures prologues vantant le sectarisme de masse,
Est-ce là vocation sortie d’esprits malingres ?
Pas penser, pas panser, arbitraires pervers.
Symboles mornes torchant les ignominies veules,
Ceux qui n’ont d’existence que des plus ravis,
Grisées tribunes dépravées sous la lune brune,
Serviles postures cernées des venins d’échafauds,
Sont-ce là poncifs servis à desseins comptables ?
Pas penser, pas panser, vilénies clandestines.
Média-sapiens communiant sophisme de titres,
Inaptes paralogismes, ineptes transmissions.
Celles perdues dans des gloses de substitution,
Ceux viciés aux bagagistes, voyages en leasing,
Est-ce ici parfum d’agences en monde perdu ?
Pas penser, pas panser, fronts sans-souci.
Grand homme sans spécialité riche comme Crésus,
Ceux qui n’ont d’esthète que panégyriques soldés,
Estrades de bourrades sans veilleurs de portiques,
Avis stérilisés comme noces admirables,
Sont-ce ici litanies sans paille dans l’acier ?
Pas panser, pas penser la volonté d’Hydres,
Vois-là, voici la grande prière est lâchée ;
Espérance gourde comme costumiers sans mémoires,
Oubliés déchets, débris, marches douteuses,
Salonardes sans lanternes comme pousse-pousse sans but,
Sont-ce, ici et là, rustines en blouses blanches et noires ?
Pas penser, pas penser, aux pantins gourous-girouettes,
Com-nommés consommés comme avidité ;
L’inutilité aux atours des temples amas-zones,
Celle imposée sous toile de tissus percés,
Étals virtuels soumissionnés aux labeurs pauvres,
Est-ce là territorialisme sans compromis(es) ?
Pas panser, pas penser, aux vendeurs de chimères…
Si l’économie était contrôlable, le monde devrait être – en toute logique – équilibré et rationnel ; or il est de plus en plus inhumain, déséquilibré et irrationnel.
Il n’y a pas de réelle valeur derrière un prix : la seule chose qu’il y ait, là, masqué, c’est un rapport de force entre les hommes.
Le genre humain se découvre à sa grande surprise au bord de l’extinction. Sommes-nous outillés pour l’empêcher, ou tout du moins analyser les causes qui on amener à ce changement ?
« On nous a traité de ‘’Semeurs de panique’’. C’est bien ce que nous cherchons à être.
C’est un honneur de porter ce titre. La tâche morale la plus importante, aujourd’hui, consiste à faire comprendre aux hommes qu’ils doivent s’inquiéter et doivent ouvertement proclamer leur peur légitime. » Günther Anders.
Une espèce au bord de l’extinction, à sa grande surprise.
Or l’homme s’est conduit jusqu’à présent comme un lemming : envahissant la terre sans nul souci de rendre durable et renouvelable l’usage qu’il a du monde qui l’entoure.
Il y a cinquante ans à peine, l’espèce humaine s’imaginait triomphante ; elle se découvre aujourd’hui au bord de l’extinction. A cette menace, elle ne répond que mollement, à la limite de l’indifférence ou – ce qui revient au même d’un point de vue pratique – en tentant de dégager un bénéfice commercial à toute tentative de réponse. C’est-à-dire en ignorant de facto l’urgence et l’ampleur du péril.
Comment cela s’explique-t-il ?
Un bilan initial s’impose : tentant de définir ce qui caractérise le genre humain.
Cette première question ayant été clarifiée, un seconde se pose aussitôt : notre espèce est-elle outillée pour empêcher sa propre extinction ?
La réponse à cette question ne souffre malheureusement pas d’équivoque : sa constitution psychique et son histoire jusqu’ici suggèrent qu’elle n’est pas à la hauteur de la tâche.
Alors que faire ?
Espérer un sursaut : faire que l’espèce s’intéresse à son sort – ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent, tant la découverte que chacun d’entre nous est mortel l’a plongée dans une stupeur profonde dont plusieurs années de rumination ne sont pas parvenu à la faire émerger. Avant de pouvoir prendre conscience de l’extinction probable, puis d’y faire face, il faudra d’abord que le genre humain sorte de sa dépression chronique. Il ne pourra prendre son sort en main qu’après avoir acquis une certaine fierté, ayant compris le sens véritable de la vie : faisant sens en soi pleine et autosuffisante, sans avant ni après.
La manière dont il en sera parlé : On parle d’une « conversation à bâtons rompus » mais peut-on imaginer un « monologue à bâtons rompus » ?
Si la chose avait un sens, on ne serait guère éloigné alors de ce que la psychanalyse qualifie d’« Association Libre… » Mais l’association libre se caractérise, encore, par les sauts du coq-à-l’âne, du moins pour l’interlocuteur, puisque c’est le mérite de Freud d’avoir souligné qu’il n’y a rien qui fasse d’avantage sens précisément pour le locuteur – celui qui énoncent – que ce qu’il ou elle dit sans liens apparent, car, sous-jacent à ce qu’il semble être des sauts dans la continuité, ce trouve le lien implicite : le sens de toute sa vie jusque-là pour un être humain qui n’a pas d’autre choix de dire ce qu’il s’entend effectivement dire.
Dans « un monologue à bâtons rompus », les règles sont différentes : l’auteur des propos sait qu’il est entendu, et non pas par un psychanalyste qui lui a précisément enjoint de dire « tout ce qui lui passe par la tête, en ignorant les incohérences éventuelles », mais par quelqu’un qui pourrait être d’un autre AVIS.
Il lui faudrait donc tenir compte des objections possibles et se les faire à l’avance, coupant l’herbe sous le pied d’un contradicteur ou une contradictrice éventuelle.
Je ferai de mon mieux…
« La mort ça vous soutient » disait : Lacan à Louvain, en octobre 1972 – une autre illustration éventuelle de mon hypothèse de la pulsion de la mort comme issue de secours :
« La mort est du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr ; ça vous soutient. Si vous n’y croyez pas, est-ce que vous pourriez supportez la vie que vous avez ? Si on n’était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira est-ce que vous pourriez supportez cette histoire ? Le comble du comble c’est que vous n’en êtes pas absolument pas sûr. » Il n’y a pas que l’emprise du monde extérieur qui agit sur nous : il y a aussi l’emprise de la dynamique qui nous agite intérieurement. Elle fait irruption dans la petite lucarne de notre conscience, reflétant le bilan en termes d’affect de la cuisine intérieure qui s’y concocte qui s’y exprime comme plaisir ou comme insatisfaction, soit ce que nous ressentons comme excitation ou comme anxiété.
Le Surmoi est le comptable de nos affects.
Le « sentiment de culpabilité », le sentiment d’une faute à réparer – cette spécialité du Surmoi –, c’est alors le pic dans la valeur d’affects du souci attaché à la réalisation de la tâche qui a été projetée (dans l’avenir), valeur qui s’effondrera, sera relaxée par la réalisation effective. Combien de portes, de fenêtres bien closes et de systèmes d’alarme divers le bourgeois doit-il s’assurer pour dormir sur ses deux oreilles ? Quant à l’emprise qui s’exerce sur nous de l’intérieur même du corps, elle demeure irréductible et, aussi longtemps que nos yeux, notre palais et notre nez feront des choix qui auront l’heur de déplaire à notre estomac, la lutte contre l’emprise restera hélas un combat perdu d’avance.
« Le dernier qui s’en va éteint la lumière’’ propose une description réaliste et véridique de notre espèce, de ses grandes forces et de ses faiblesses.
Anthropologue et sociologue Paul Jorion est connu du public pour avoir annoncé la crise des subprimes. Il a révolutionné le regard porté sur l’économie et la finance
Si l’écologie ne parle pas aux classes populaires le risque serait une aggravation du schisme écologique, un renoncement civique et une divagation intellectuelle entre les différentes solutions possibles.
La voie à emprunter ne serait-elle pas celle de l’ethno-anthropologie sociale-économique qui s’attache à entrevoir une thésaurisation qui ne soit coupée ni du politique ni du social, mais «sertie» à l’intérieur de l’ensemble (E) des êtres humains, ayant réussi à entrevoir l’utilité des mots affiliés au discours humaniste d’entre les sciences, les arts et la poésie. Toutes autres voix seront, tôt ou tard, par la loi des nombres, vouées à l’anomie de cet ensemble systématiquement dirigé vers la destruction de l’humanité. La confiance ne saurait exister dans les intérêts particuliers dénués de toute attention.
Depuis longtemps déjà, la crise des humanités nous menace. Ou du moins, c’est ainsi qu’on en entend parler. Les spécialistes d’études classiques s’inquiètent de la logique marchande qui ferme départements et facultés, coupe dans les budgets, et réduit les effectifs. Certains tentent de répondre à des chiffres par des chiffres, et à un déficit de popularité par un gain de popularité.
L’hypothèse défendue ici est que les humanités auraient avantage à travailler sur les objets populaires actuels. Par « objets » je désigne des artefacts, des produits matériels d’activités humaines comme des textes, des tableaux, des sculptures, des partitions de musique, ou des téléphones mobiles. Nous souffrons, en partie, du décalage bien connu et d’ailleurs, souvent étudié, entre haute et basse culture. Il y a évidemment des exceptions, les historiens et les linguistes, par exemple, mélangent différents types de sources et vont jusqu’au présent, mais la plupart des collègues ne s’intéressent simplement pas aux objets produits par ou à l’ATTENTION de la majorité de la population qui les entoure. Humanités Populaires – La culture des objets
J’aimeJ’aime