


Mary Ellen Mark



Lahem

Debi Cornwall





à gauche: Randa Mirza, à droite Rajesh Vora



Nicolas Floc’h





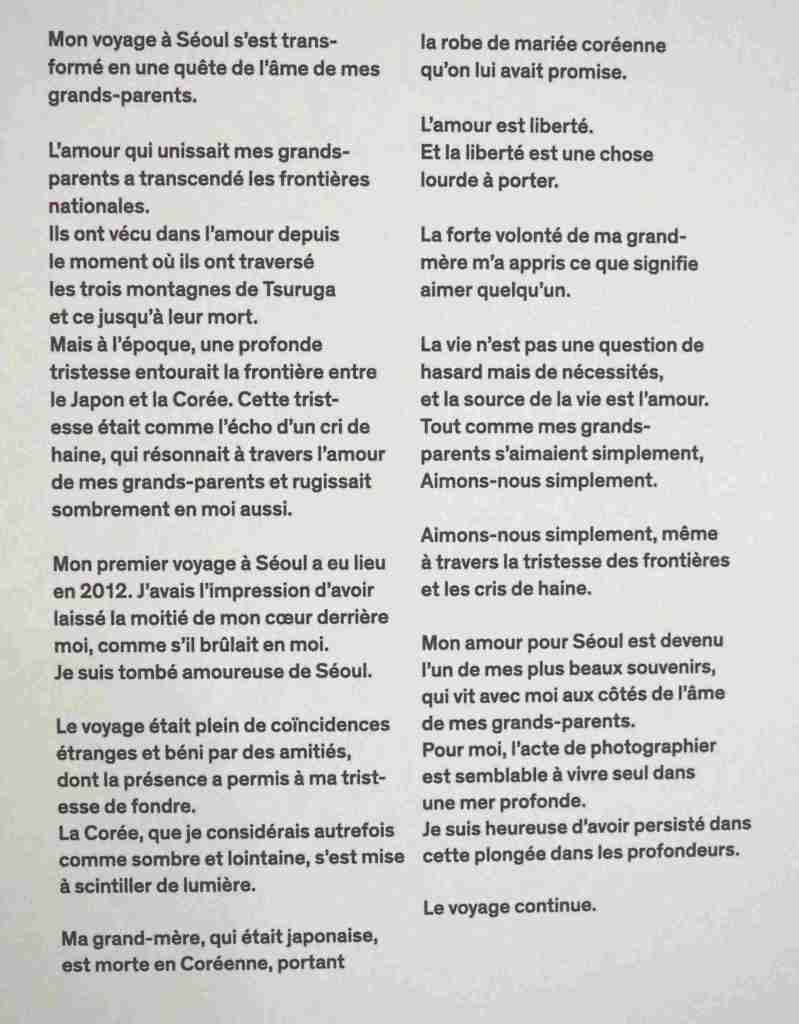
Tonomura Hideka

Suzuki Mayumi

Yoshida Tamaki




Marine Lanier, Nhu Xuan Hua et Vimala Pons



Un peu de mistral a fait baisser la température. On peut marcher léger le long des façades des vieilles maisons bourgeoises un peu lézardées, parfois transformées en musées, ou parfois à l’abandon auprès des chapelles devenues salles d’exposition, pousser la randonnée jusqu’aux confins de la gare, près d’une friche d’entrepôts devenus Ground Control, et revenir en passant par le Monoprix, dans lequel on pénètre comme si l’on était un voleur, par l’arrière, franchissant de vieux débris et des mottes de terre. Vers le boulevard Emile Combes, on voit encore des maisons à l’allure de mas de l’ancien temps, aux volets couverts de peinture bleue pâle, un hangar encore qui est devenu la « maison des peintres », et beaucoup plus loin, le complexe de La Croisière, ensemble de salles d’exposition, de cinéma en plein air et de buvette réfectoire vendant des sandwiches et des salades grecques. Puis le Boulevard des Lices conduit vers d’anciens ateliers des chemins de fer, vers la tour LUMA de Franck Gehry, un peu en face du bâtiment long et plat, de verre et d’acier de l’Ecole nationale supérieure de la photographie. Arles, une ville désormais dévolue à l’art : en mai, nous y voyions le festival international du dessin, début juillet et en ce milieu d’août, les rencontres internationales de la photographie. Qu’en pensent les vieux arlésiens ? Ils ne semblent pas s’en plaindre même s’ils ont peut-être encore au fond d’eux-mêmes une préférence pour les plaisirs d’antan, comme ces deux hommes assis sur la place du Forum, vers dix heures du matin, se faisant part de leurs impressions après avoir vu – à la télé – les dernières courses qui se sont déroulées aux arènes de Béziers. A les en croire, tel torero au nom espagnol avait reçu de façon méritée une, voire deux, oreilles. On apprend ainsi, incidemment, que la corrida est toujours légale en France en ces temps où l’on a commencé de s’émouvoir, à juste titre, des souffrances infligées aux animaux. Mais tradition tradition… (les spectacles tauromachiques sont exceptionnellement tolérés dans les régions où une tradition locale s’y manifeste de manière ininterrompue depuis un bon laps de temps).
Les itinéraires dans Arles se croisent et se recroisent, on peut revenir au point de départ par un tout autre chemin, atteignant la chapelle de Méjean, proche de la librairie Actes Sud, puis suivant les paneaux indiquant la direction du musée Réattu, jusqu’à atteindre une petite rue transversale, la rue de Grille, au 14 de laquelle ouvre un petit espace dénommé Café-Vague. Ensuite on peut reprendre la direction de la porte des remparts qui ouvre à nouveau vers le chemin de la gare. On peut aussi tirer plutôt du côté des Arènes et se retrouver, héberlué, au sommet d’une colline de laquelle se laisse contempler la mer des toits d’Arles, tous de tuiles provençales, avec au loin, entre deux arbres, la silhouette de l’abbaye de Montmajour ; on longe la façade de l’église de la major, après deux virages parmi de vieux édifices romans, on découvre une église oubliée qui, elle aussi, a été transformée en lieu d’exposition : l’église Saint Blaise (toute proche d’une rue Blaise Pascal, bien évidemment). La descente fera basculer sur le petit jardin d’été qui longe le boulevard des Lices déjà aperçu. Ce faisant nous avons ignoré le centre, l’église Sainte Trophime, le palais de l’archevêché, l’église Sainte-Anne, entourant l’obélisque, et la rue de l’hotel de ville, bordée de galeries et de restaurants. Perpendiculaire à elle, avant d’atteindre la place en venant du boulevard, celle de la République qui longera le museon Arlaten et surtout conduira à l’espace van Gogh… On n’aura pas vu encore l’Église des Frères Prêcheurs. Tout cela viendra ensuite quand on aura digéré les expos présentes au long de ces parcours…
Les expos… si on commence par le haut du plan, donc la plus excentrée au Nord-Est, près de la gare, au Ground Control, là où, à mon goût, les mises en valeur sont les moindres, une expo étrange, Fashion Army, d’un collectionneur ayant exhumé de vieux cartons des photos d’uniformes et de tenues spéciales de soldat.e.s américain.e.s, habitées par un humour sarcastique, comme la tenue intégrant une toilette ambulante. Rien à voir avec l’expo voisine qui, elle, nous raconte l’enfance d’un artiste chinois de retour en son village qui n’a guère changé depuis qu’il était petit (Lahem). L’oeil malicieux de l’enfant comme un appel à s’immiscer dans un monde hors du temps coincé au plus profond de la Chine.
A Monoprix, une américaine, Debi Cornwall, montre comment l’on fabrique des citoyens et comment l’on forme les soldat.e.s au combat et à la traque des fugitifs dans des paysages désertiques qui ressemblent sciemment à l’Irak ; elle photographie aussi des rallyes trumpiens.
A la Maison des peintres, Rajesh Vora est allé dénicher d’incroyables villages au fond du Pendjab où les propriétaires de villas rivalisent d’exploits pour décorer les toits de leurs maisons, on y voit des haltérophiles musculeux, des chars d’assaut, des voitures de toutes les formes et surtout des avions, long courriers aux couleurs de toutes les compagnies aériennes. A côté de lui, une artiste libanaise, Randa Mirza, essaie de retracer le drame de son pays, elle photographie la foule dans la position d’un sniper et montre l’avant/l’après de la terrible explosion du 4 août 2020.
A la Chapelle de Méjean, Nicolas Floc’h nous montre le Mississipi tel qu’il l’a photographié de l’intérieur et de l’extérieur. De l’intérieur cela donne d’immenses photos monochromes qui ont la couleur du minerai ou des déchets qui se sont déposés en fonction de leur environnement, de l’extérieur, de somptueux noir-et-blanc des campagnes américaines et des villes comme Minneapolis.
Au Café Vague une jeune artiste japonaise, Tonomura Hideka fait un hymne à l’amour à propos de celui que se sont voués toute leur vie ses grands-parents bien qu’ils fussent l’une japonaise et l’autre coréen. « L’amour est liberté » dit-elle. Une de ses co-exposantes, Suzuki Mayumi, fait le lien entre les corps et les végétaux, les semences du corps et les graines des légumes. Une autre encore, Yoshida Tamaki, a fixé de grandes toiles pour recueillir les mouvements de la forêt.
Marine Lanier, au Jardin d’été continue sur la lancée des graines et des végétaux mais en très grand format, au voisinage de portraits géants de jeunes hommes et femmes énigmatiques, à vrai dire les « jardiniers », à la tête couverte d’une capuche.
