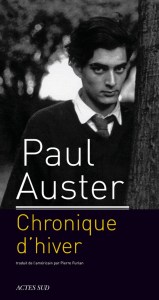L’annonce du décès de Paul Auster ce 30 avril (annonce faite, au dire du Monde, par une amie de la famille sans, semble-t-il, le consentement de ses proches et notamment de son épouse Siri Hustvedt, ce qui est mal comme l’a dit cette dernière) m’a causé de la tristesse. Non que ce fût mon auteur préféré, j’avais lu en effet bien peu de choses de lui jusqu’ici, si ce n’est, il y a plus de trente ans, sa trilogie new-yorkaise, bien plus récemment, son livre écrit avec son gendre photographe sur les crimes de masse perpétrés aux Etats-Unis et, plus récemment encore, son dernier roman, Baumgartner, dont j’avais dit ici tout le bien que je pensais, mais, peut-être justement à cause de ce dernier livre, en raison du fait qu’il venait d’entrer dans ma vie.

France, Paris, octobre 1998
Portrait de Paul Auster, écrivain américain.
Ludovic Carème / Agence VU
Curieuse coïncidence que quelqu’un entre dans votre vie au moment où il va mourir, d’autant que tous les deux, lui et toi, aviez le même âge et que donc vous auriez pu vous rencontrer bien avant (je dis ici « rencontrer » au sens virtuel car je n’irai pas jusqu’à croire que j’aurais pu le rencontrer dans la vie réelle, et j’emploie la seconde personne du singulier pour me désigner à dessein afin de me conformer à l’usage du dernier livre que je viens de lire de lui). Pas étonnant donc que, passant récemment à Arles devant la librairie de Actes-Sud qui fut sa maison d’édition française, tu te rues sur le rayon de ses livres, dont évidemment, la plupart sont actuellement en réimpression. Tu jetais donc ton dévolu sur Chronique d’hiver, que tu avais ignoré au moment de sa parution (en 2012 aux Etats-Unis, en 2013 en France). C’est un livre où Auster se penche sur son passé à partir du point de vue conféré par un âge qui, à l’époque, lui semble canonique alors qu’il paraîtrait aujourd’hui à lui comme à toi la prime jeunesse : soixante-quatre ans. A ce moment, il lui reste donc encore treize années à vivre et nous ne saurons sans doute jamais les événements et les sentiments qui auront jalonné cette fin d’existence, en tout cas nous ne les saurons jamais racontés par lui. 251 pages pour raconter sa vie, c’est bien peu. Il faut y introduire des tours de magie et des lueurs d’intelligence en permanence qui vont permettre de pratiquer l’ellipse en ne montrant de soi qu’une partie, certes, mais la plus significative.
Plus que la chronologie de ses souvenirs, ce sur quoi se penche Auster est l’histoire de son corps, des souffrances qu’il a endurées, des marques qu’il a subies. Et oui, quel meilleur guide à travers soi que son propre corps ? N’est-il pas l’éternel compagnon, le témoin ultime de nos souffrances comme de nos joies ? Il s’agit peut-être d’une constante d’ailleurs, le long de son œuvre, en tout cas de la plus récente, puisque dans Baumgartner encore, le personnage central faisait irruption dans notre conscience au travers de ses douleurs, brûlure à la main (ayant saisi une casserole surchauffée car il l’avait oubliée sur le feu), puis au genou suite à une chute dans l’escalier de sa cave (comme sa main lui faisait mal, il n’avait pas pu tenir la rampe). Ici, dans cette Chronique, cela commence dès l’âge de trois ans et demi quand, accompagnant sa mère dans les rayons d’un supermarché de Newark et y ayant rencontré un petit camarade, il entreprend en sa compagnie de faire de longues glissades sur la surface lisse du sol, jusqu’à, évidemment, atterrir sur un établi de menuisier en bois et se faire très mal à cause d’un clou qui dépasse et lui déchire la joue. Première cicatrice. Plus tard, à douze ans, ce fut, au cours des premiers jeux de balle, la percussion par un gros balourd de ses copains fonçant sur lui, qui le laissa au sol, inconscient et transporté à l’hôpital où un certain docteur Kohn lui fit les points de suture indispensables. Nouvelles cicatrices.
A plusieurs étapes de sa vie, son corps a traduit les émotions qu’il a vécues, comme lorsqu’il a cru souffrir d’un infarctus et qu’il n’avait qu’une irritation de l’œsophage (après s’être bourré d’un sandwich au thon!), lorsqu’il a souffert des yeux (déchirement de la cornée gauche, puis droite) ou qu’il a eu un caillot de sang dans la jambe à la suite d’un voyage New-York Copenhague en classe économique, ce qui l’a contraint à rester immobilisé pendant plusieurs semaines puis à marcher avec une canne pendant plusieurs mois, ou bien lorsqu’il a fait de terribles crises de panique, notamment après le décès de sa mère. Il raconte aussi l’accident qu’il a eu en rentrant chez lui avec sa femme et sa fille. Pendant tout le trajet en voiture il n’était pas très bien, sa femme le mettait en garde sans arrêt mais finalement, tout allait bien se terminer, ils allaient enfin être chez eux, lui était un peu impatient (il avait envie de pisser), alors au moment de tourner à gauche dans une grande avenue, tout près de leur maison, il a estimé qu’il avait le temps de passer avant qu’un fourgon n’arrive au carrefour, mauvaise appréciation, le fourgon allait beaucoup plus vite que la normale et il y eut une forte collision. Sa femme Siri restait immobile, on craignait qu’elle ne se fût briser la nuque, fort heureusement, il n’en fut rien. Mais depuis, il avait cessé de conduire. Il raconte la mort de ses parents, qui avaient divorcé, le père crise cardiaque en faisant l’amour, ce qui, contrairement à ce que l’on pense souvent, n’est pas une belle mort… en tout cas pas pour le ou la partenaire, la mère morte à 77 ans, ce qui s’avérera justement être l’âge de la mort de Paul en 2024. Il parle beaucoup de son enfance et du rôle joué par le sport (base ball, football américain).
Il raconte aussi ses souvenirs sexuels, très tôt son réconfort d’avoir un compagnon en la personne de son sexe qui lui apparaît alors ressemblant, de par cette sorte de casque qui le domine, à un petit pompier. Puis un beau jour, le petit pompier se montre lieu de béatitude et alors, toute son adolescence est mobilisée par une seule chose. Au début, des flirts innocents avec plein de filles de son lycée, on n’ose pas trop toucher la chair, juste effleurer les seins au travers des pulls et des chemisiers, on a connu ça nous aussi, puis l’amour avec des prostituées, dont une à Paris, qui lui dira des vers de Baudelaire.
Un corps, malheureusement ou heureusement, cela demande à être casé, mis à l’abri, protégé, hébergé sous un toit, alors à un moment du récit, il décide de prendre comme cadre de narration la liste des divers logis qu’il aura occupés dans sa vie, en tout vingt et un au moment où il écrit, dont plusieurs en France dans les années 71-74, à Paris (3 rue Jacques Mawas, 29 rue Descartes etc.) mais aussi en Provence, près d’Aups, où il vit avec sa compagne d’alors (relation difficile, faite d’aller-retours. Il épousera celle-ci à son retour aux Etats-Unis, un moment en Californie, et ils auront un premier fils, né en 1977. mais très vite ils divorceront, en 1978).
Il fait à Paris la rencontre des Français, et ce n’est pas triste à lire ! Paul Auster détaille avec lucidité nombre de nos défauts, à nous Français, de quoi nous rendre pas si fiers de l’être. Son premier logis parisien sera situé au 3 de la rue Jacques Mawas, dans le quinzième arrondissement, où il fait venir un accordeur de piano aveugle qui lui dit, avec une sorte de satisfaction, qu’il a lui-même habité dans cette rue pendant la guerre car, lui dit-il, il y était facile de trouver un appartement. Pourquoi ? Parce que les Juifs (il dit « israëlites ») qui habitaient là « étaient partis ». Ah bon, et où étaient-ils partis ? Ca je ne sais pas, mais en tout cas presque aucun n’est revenu. Auster est stupéfait. Au début, il ne comprend pas très bien, ou bien il refuse de croire ce que l’autre lui dit. Puis il se rend à l’évidence. Telle a été écrit Auster la première d’une série de leçons sur la vie à la française qui t’ont été inculquées à la dure dans cet immeuble. La deuxième viendra d’un épisode de la Guerre des Tuyaux. Il n’a pas fait attention au fait que la chasse d’eau coulait au grand dam des voisins ; il reçoit un mot de la voisine du dessous qui lui annonce qu’elle a écrit au propriétaire et que si celui-ci ne l’expulse pas, elle sera prête à le dénoncer à la police. Auster voit là une caractéristique des Français qui, plutôt que chercher un accord à l’amiable sont toujours prêts à passer d’abord par la loi et les autorités. Une foi illimitée en la hiérarchie du pouvoir, une croyance aveugle dans les voies de la bureaucratie pour redresser les torts et rectifier la plus petite injustice. La même dame fulmine quand la compagne de Paul, venue à Paris, joue du piano l’après-midi, alors il va tenter de s’expliquer avec elle et ainsi fait sa connaissance, elle s’appelle madame Rubinstein. Alors qu’ils s’invectivent, il a la lumineuse idée de lui dire qu’il est bien triste que deux Juifs soient en train de se disputer de la sorte, et cela réussit… à l’avenir elle le saluera et cessera de l’importuner.
Ces Chroniques sont aussi parcourues par la mort. Pas étonnant quand il s’agit du corps et de ses aspérités. Auster passe en revue toutes ses rencontres avec elle, depuis la fois où, lorsqu’il avait 14 ans, il a vu un de ses copains à 30cm de lui se faire foudroyer. Et du côté familial l’apprentissage tardif que sa grand-mère paternelle avait tué son grand-père un soir de dispute. En mai 2002, il a au bout du fil sa mère qui lui semble plus heureuse qu’elle n’a jamais été. Il reçoit un coup de téléphone le lendemain qui lui annonce qu’elle est morte. Il part alors dans le New Jersey où elle habite et là, il est complètement perdu, il reçoit l’aide d’une cousine et de sa fille, il est titubant et va très mal. Il boit plus que de raison et s’endort, il est réveillé par la voix d’une autre cousine qui lui glapit le pire mal de sa mère défunte. Le voilà ramené à ce qu’il a à peine soupçonné lorsqu’il était enfant, la mésentente entre ses parents, les vagabondages de sa mère, un échange téléphonique surpris où la voix d’un homme disait au revoir et où sa mère répondait au revoir chéri.
Dans un passage en revue des parties du corps, il s’arrête sur la main, raison de citer un poème de Keats (« Cette main vivante, à présent chaude et capable / D’une étreinte fervente, ne manquerait, serait-elle froide / Et dans le silence glacial de la tombe,. De hanter tant tes jours et tant transir les rêves de tes nuits / Que tu souhaiterais ton coeur tari de sang / Pour qu’en mes veines à nouveau puisse la vie rouge affluer, / Et toi calmer ta conscience. Regarde la voici / Vers toi, vers toi, je la tends… »), mais aussi d’évoquer Joyce répondant à une femme se déclarant tellement honorée de serrer la main qui a écrit Ulysse : « Permettez moi de vous rappeler que cette main a fait aussi bien d’autres choses ».
Et puis les fois où il s’est vraiment fâché où il a été prêt à cogner, comme lorsqu’il a pris le train un 1er septembre en France, venant d’Avignon, dans une terrible cohue comme seuls les connaissent les moments de départ ou de retour de vacances en France, et qu’à l’arrivée à Paris, pris avec sa femme et sa fille dans la bousculade au moment de prendre le taxi, il essaie de prendre ses bagages pour aller à une autre station où là, un chauffeur de taxi refuse de les emmener parce qu’ils vont trop près ! Il jette de rage un sac contre la voiture, le chauffeur en sort furieux pour lui casser la gueule, mais lui est encore plus furieux et prêt à en découdre, si bien que le chauffeur bat en retraite. Auster excelle dans la manière d’établir des contrastes, ici entre ces deux hommes qui fulminent et une femme noire qui passe, nonchalamment, en charriant sans efforts ses bagages sur sa tête.
Mais surtout, ce court récit de vie est parcouru d’une lumière, d’une providence, celle qu’irradie la femme de sa vie, Siri Hustvedt, qu’il a rencontrée, il s’en souvient bien, le 23 février 1981, « vingt jours après ton trente-quatrième anniversaire et seulement quatre jours après son vingt-sixième, tu l’as rencontrée, l’Unique t’a été présentée, la femme qui est avec toi depuis ce soir-là il y a trente ans, ta femme, le grand amour qui t’a pris par surprise au moment où tu t’y attendais le moins ». Quel duo magnifique ils auront ainsi formé pendant plus de quarante ans, tous deux aussi grands écrivains l’un que l’autre, lui avec cette œuvre qu’on lui connaît, elle avec ses multiples talents qui la font autant romancière qu’essayiste, et qui ont commencé leur vie de couple en se lisant des histoires.
Au moment où est écrit cette Chronique, Paul Auster traduit des poètes français pour établir une anthologie. Parmi eux figure Joseph Joubert, poète et moraliste mort en 1824. Joubert avait écrit : « La fin de la vie est amère ». Et Paul ajoute : « Neuf mois après avoir écrit ces mots à soixante et un ans, il note, à propos de la fin de vie, une formule non seulement différente mais bien plus exigeante : il faut mourir aimable (si on le peut). Si on le peut. Il n’est probablement pas d’accomplissement humain plus grand que d’être aimable à la fin, que cette fin soit amère ou pas ». Voilà bien en somme le message qu’Auster aura voulu nous laisser. Essayer d’être aimable, même à la fin, c’est sans doute le programme le plus ambitieux que nous puissions avoir, plus ambitieux que toutes les résolutions de premier janvier ou que toute promesse faite à soi-même de combattre les injustices. Il a l’avantage d’impliquer peu de monde, n’engageant que nous-mêmes.
Sur la fin, il entendra la voix des morts : il se rappelle un voyage fait à Hambourg avec son éditeur allemand, ils ont l’idée d’aller à Bergen Belsen, et là, surplombant un endroit où il est dit que 50 000 soldats soviétiques sont enterrés, il a une hallucination : il entend les morts hurler.
La Terre hurlait…
Auster fait partie de ces grands romanciers (beaucoup sont américains, mais certains ne le sont pas, comme Rushdie ou Murakami, ou bien, parmi les Français, Le Clézio ou Modiano) qui réussissent à créer un monde hors duquel, dès que nous y avons pénétré, nous avons peine à sortir, ils ont usé toute leur vie, toute leur énergie, à le faire vivre, souvent ce monde emprunte à leur vie propre, comme ici, d’autres fois aux récits et aux histoires qu’ils ont entendus dans leur jeunesse. Les personnages qui le peuplent sont nos voisins, nos amis. Lire leurs romans c’est comme entreprendre un voyage, et de ce point de vue, je ne vois guère de différence entre le fait de décrire l’un de mes périples (comme celui, récent au Japon et en Corée) et celui de décrire le contenu d’un livre que j’ai aimé. C’est pourquoi aussi la littérature nous apprend tant, nous montrant ce que nous ne pouvons percevoir par nous-mêmes car nous n’avons que le temps d’une seule vie, et pourquoi aussi elle est souvent plus forte que la théorie.